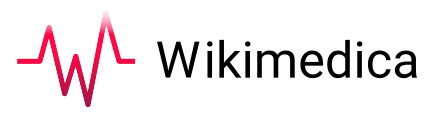Température corporelle élevée (signe clinique)
| Signe clinique | |
| Données | |
|---|---|
| Système | Neurologique, hématopoïétique |
| Modalité |
Signes vitaux |
| Informations | |
| Terme anglais | Fever, hyperthermia |
| Autres noms | Hyperthermie, pyrexie, état febrile |
| Spécialités | Infectiologie, Médecine de famille |
|
| |
pour les approches cliniques, voir Fièvre chez l'adulte (approche clinique), fièvre chez un nouveau-né ou un enfant (approche clinique), fièvre postopératoire (approche clinique), fièvre chez un patient immunosupprimé (approche clinique)
La fièvre ou l'hyperthermie (T°) est l'augmentation de la température interne du corps (généralement > 37,8 °C orale ou > 38,2 °C rectale) par rapport à la normale (environ 37 °C).[1]
La fièvre est une condition où l'hypothalamus élève le seuil de la température centrale tout en permettant au corps de maintenir ses organes fonctionnels et sous contrôle. L'hyperthermie, d'un autre côté, est une condition où la température corporelle augmente au-delà de la des capacités de contrôle de l'hypothalamus.[2]
Questionnaire
Généralement, le patient sera en mesure rapporter faire de la fièvre ou en avoir fait. Lorsque le thermostat du corps se règle à une plus haute température, le patient aura froid et rapportera des frissons dans les cas de forte fièvre (le corps est en quelque sorte en hypothermie). Lorsque le thermostat du corps retourne à son point d'origine, c'est le contraire qui se produit; le patient rapporte avoir chaud et aura des sudations (car le corps est en quelque sorte en hyperthermie).
Examen
Fièvre chez l'adulte (approche clinique)L'inclusion depuis Fièvre chez l'adulte (approche clinique) est brisée car la page cible n'existe pas.
Physiopathologie
Fièvre chez l'adulte (approche clinique)L'inclusion depuis Fièvre chez l'adulte (approche clinique) est brisée car la page cible n'existe pas.
Références
- ↑ « Fièvre - Maladies infectieuses », sur Édition professionnelle du Manuel MSD (consulté le 9 mars 2024)
- ↑ Swetha Balli, Karlie R. Shumway et Shweta Sharan, Physiology, Fever, StatPearls Publishing, (PMID 32966005, lire en ligne)