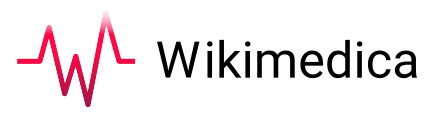Syndrome post-embolisation
| Maladie | |||
 | |||
| Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|
| Signes | Douleur à la palpation abdominale , Température corporelle élevée | ||
| Symptômes |
Myalgies, Douleur pelvienne, Céphalée , Asthénie , Douleur abdominale , Douleur abdominale, Vomissement , Nausées , Procédure d'embolisation, Arthralgies , ... [+] | ||
| Diagnostic différentiel |
Sepsis, Syndrome de lyse tumorale, Abcès hépatique, Abcès tubo-ovarien, Hépatite, Abcès rénal, Pyélonéphrite aiguë, Atteinte inflammatoire pelvienne, Abcès utérin | ||
| Informations | |||
| Terme anglais | Post-embolisation syndrome | ||
| Spécialités | Radiologie, oncologie | ||
| |||
Le syndrome de post-embolisation (SPE) est une des complications les plus communes des procédures d'embolisation, suite à un infarctus tissulaire. Ce syndrome englobe la douleur, la fièvre, des nausée ou des vomissements, et se manifeste dans les 72 heures après l'embolisation[1][2][3]. Peu d'études ont été effectuées sur le sujet.
Épidémiologie
Il a été rapporté que le SPE se manifeste chez jusqu'à 89% des patients subissant une embolisation artérielle rénale (EAR)[4], ainsi que chez plus d'un tiers des patients ayant subit une chimioembolisation transartérielle (CETA).[5]On retrouve le SPE chez environ 25,5% de ceux ayant subit une embolisation de l'artère prostatique (EAP)[6], et à une plus faible prévalence chez ceux ayant subit une embolisation de tumeur cérébrale (ETC); on parle alors ici de syndrome neurologique de post-embolisation (SNPE)[7]. La littérature rapporte aussi des cas de SPE suite à l'embolisation partielle de l'artère splénique (EPAS).[8]
Étiologies
L'étiologie principale est l'embolisation, que l'on retrouve surtout lors des procédures suivantes :
- la CETA: usage d'agents chimiothérapeutiques comme la cisplatine ou la doxorubicine pour emboliser l'artère hépatique afin de diminuer l'influx sanguin du cancer du foie et ainsi diminuer le volume de la tumeur[9]
- l'EAR: agent embolisant amené avec cathéter vers l'artère rénale pour diminuer l'apport sanguin vers la tumeur rénale[10][4]
- l'embolisation d'un fibrome utérin: aussi avec un agent embolisant, pour diminuer l'apport sanguin des artères utérines et donc l'apport sanguin aux fibromes utérins[11]
- l'ETC : embolisation du vaisseau sanguin vascularisant une tumeur cérébrale, par des agents embolisants dont l'alcool et des agents chimiothérapeutiques[12][7]
- l'EAP : embolisation de l'artère prostatique par microparticules avec ou sans onyx ou glubran[13]
- l'EASP : embolisation de l'artère splénique avec des agents embolisants temporaires comme le Gelfoam, ou permanents comme les particules d'alcool polyvinylique ou des bobines d'acier inoxydable.[14]
Physiopathologie
La réponse inflammatoire du tissu nécrosé résultant de la procédure est à la source des manifestations; la libération de médiateurs inflammatoires et de substances vasoactives mènerait à une ischémie de la zone traité, ce qui causerait la douleur et le reste du tableau clinique.[2]
Présentation clinique
Facteurs de risque
Les facteurs de risque sont[5][15] :
- la prise de doses élevées de doxorubicine (> 75mg)
- le sexe féminin
- la taille de la lésion : plus la cible est volumineuse, plus le risque de SPE augmente
- la présence d'un carcinome hépato-cellulaire (CHC) avancé et non résectionnable
- la procédure de CETA conventionnelle
- la présence d'une atteinte tumorale hépatique bilobaire.
Questionnaire
Les symptômes apparaîtront dans les 72 heures[1] et sont [2]:
- de la douleur abdominale : souvent le premier symptôme qui apparaît, selon la procédure, on peut retrouver une douleur à l'hypochondre droit ou l'hypogastre, suite à une CETA ou une EAR respectivement; une embolisation de fibrome utérins donnera une douleur pelvienne
- des nausées et des vomissements
- une céphalée en contexte de ETC
- de la fièvre
- des myalgies
- des arthralgies
- une faiblesse.
Il y aura forcément un lien temporel avec une procédure d'embolisation [Pr: 100 %].
Examen clinique
L'examen clinique permettra d'objectiver:
- aux signes vitaux: fièvre[2]
- à l'examen de l'abdomen :
- s'il y a eu CETA: douleur à la palpation de l'hypochondre droit
- s'il y a eu EAR: douleur à la palpation de l'hypogastre
- s'il y avait des fibromes utérins: douleur à la palpation sus-pubienne.
Examens paracliniques
Il est recommandé d'effectuer les examens paracliniques suivants[1] :
- une tomodensitométrie abdominale ou une IRM : ces imageries permettront d'évaluer la taille de la tumeur et l'efficacité de l'embolisation
- la radiographie abdominale : elle permet de détecter les gaz intralésionnels précoce
- une FSC : une leucocytose [Pr: 20 %] (elle se manifestera dans les premières 24 heures)
- un bilan électrolytique[16] : pas d'hyperphosphatémie, pas d'hyperkaliémie et pas d'hypocalcémie (vues dans le syndrome de lyse tumorale)
- une créatinine : il pourrait y avoir néphropathie aux agents de contraste concomitante, ce qui irait modifier les dosages d'éventuels médicaments
- un test d'acide urique sérique[16] : pas d'hyperuricémie (vue dans le syndrome de lyse tumorale)
- si la procédure était hépatique, un bilan hépatique pour éliminer une hépatite[17]
- si la procédure était rénale, une analyse urinaire et une culture pour éliminer une pyélonéphrite aiguë.
Approche clinique
Les notions de temporalité et de lien de causalité sont importantes pour différencier le diagnostic différentiel; le syndrome de la lyse tumorale arrivera rapidement après le traitement anti-tumoral, alors que le syndrome de post-embolisation arrivera dans les quelque jours après la procédure d'embolisation[18]. Pour les abcès, il est nécessaire d'effectuer une revue des systèmes complète et d'inclure selon le jugement clinique un examen gynécologique ou un punch rénal. L'imagerie pourra également guider le diagnostic car elle montrera généralement des stigmates de l'embolisation.
Dans tous les cas, un avis en radiologie interventionnelle est important pour appuyer le diagnostic.
Diagnostic
Le SPE est diagnostiqué chez un patient présentant les symptômes compatibles, une histoire d'embolisation récente en radiologie interventionnelle et l'absence d'indices pouvant orienter vers d'autres diagnostics.
Diagnostic différentiel
Les symptômes peuvent être concomitants avec [1]:
- un abcès hépatique / hépatite
- un abcès rénal ou une pyélonéphrite aiguë
- un abcès utérin, abcès tubo-ovarien et maladie inflammatoire pelvienne
- un sepsis
- un syndrome de lyse tumorale.
Traitement
Le SPE est habituellement auto-résolutif. Le traitement au besoin consiste en l'administration[1] :
- des analgésiques pour la douleur
- des fluides IV pour la déshydratation
- des antipyrétiques et des antihémétiques.
Un avis en radiologie interventionnelle est indiqué.
Complications
Il n'y a généralement pas de complications[1].
Évolution
La plupart des patients sont en mesure de recevoir un congé dans les 24 à 48 heures suite à l'intervention, lorsque la douleur et les nausées se sont calmées. La fièvre peut cependant rester jusqu'à 1 semaine après l'intervention[2]. À noter que le développement d'un SPE et un prédicteur précoce d'un faible taux de survie car cela implique un charge tumorale importante .Le risque de mortalité peut aller jusqu'à doubler en présence d'un SPE, particulièrement chez ceux subissant une CETA conventionnelle et ceux avec une atteinte tumorale hépatique bilobaire ou autre atteinte tumorale avancée. On considère chez ces populations plus à risque une thérapie combinée ou même la radio-embolisation transartérielle[5].
Prévention
L'approche de CETA par billes à élution médicamenteuse (CETA-BÉM) est préférée aux autres procédures d'embolisation, car elle offre moins de risque d'avoir un SPE[5]. Il est aussi possible de donner en prophylaxie des antipyrétiques et des antihémétiques.[1]
Références
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 et 1,6 (en-US) Ki Yap, « Post-embolization syndrome | Radiology Reference Article | Radiopaedia.org », sur Radiopaedia (consulté le 3 août 2022)
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 et 2,4 « Chimio-embolisation », sur www.cisssca.com (consulté le 2 octobre 2022)
- ↑ « ClinicalKey », sur www.clinicalkey.com (consulté le 17 juillet 2023)
- ↑ 4,0 et 4,1 (en) Anup Vora, Rachel Brodsky, John Nolan et Sathya Ram, « Incidence of postembolization syndrome after complete renal angioinfarction: a single-institution experience over four years », Scandinavian Journal of Urology, vol. 48, no 3, , p. 245–251 (ISSN 2168-1805 et 2168-1813, DOI 10.3109/21681805.2013.852620, lire en ligne)
- ↑ 5,0 5,1 5,2 et 5,3 Meredith C Mason, Nader N Massarweh, Aitua Salami et Mark A Sultenfuss, « Post-embolization syndrome as an early predictor of overall survival after transarterial chemoembolization for hepatocellular carcinoma », HPB : The Official Journal of the International Hepato Pancreato Biliary Association, vol. 17, no 12, , p. 1137–1144 (ISSN 1365-182X, PMID 26374137, Central PMCID 4644367, DOI 10.1111/hpb.12487, lire en ligne)
- ↑ (en) Petra Svarc, Mikkel Taudorf, Michael Bachmann Nielsen et Hein Vincent Stroomberg, « Postembolization Syndrome after Prostatic Artery Embolization: A Systematic Review », Diagnostics, vol. 10, no 9, , p. 659 (ISSN 2075-4418, PMID 32878325, Central PMCID PMC7555179, DOI 10.3390/diagnostics10090659, lire en ligne)
- ↑ 7,0 et 7,1 Yujiro Tanaka, Takao Hashimoto, Daisuke Watanabe et Hirofumi Okada, « Post-embolization neurological syndrome after embolization for intracranial and skull base tumors: transient exacerbation of neurological symptoms with inflammatory responses », Neuroradiology, vol. 60, no 8, , p. 843–851 (ISSN 1432-1920, PMID 29915915, DOI 10.1007/s00234-018-2047-8, lire en ligne)
- ↑ (en) Chaitanya Ahuja, Khashayar Farsad et Meghna Chadha, « An Overview of Splenic Embolization », American Journal of Roentgenology, vol. 205, no 4, , p. 720–725 (ISSN 0361-803X et 1546-3141, DOI 10.2214/AJR.15.14637, lire en ligne)
- ↑ Sid Lee, « Chimioembolisation transartérielle (TACE) du cancer du foie », sur Société canadienne du cancer, (consulté le 9 juillet 2023)
- ↑ Sid Lee, « Embolisation artérielle du cancer du rein », sur Société canadienne du cancer (consulté le 9 juillet 2023)
- ↑ « Embolisation de fibromes utérins », sur www.cisssca.com (consulté le 9 juillet 2023)
- ↑ (en-US) « Cerebral Tumor Embolization », sur Cedars-Sinai (consulté le 17 juillet 2023)
- ↑ Fançois Petitpierre, « Embolisation de la prostate - Radiologie Interventionnelle embolisation », sur Radiologie Interventionnelle, (consulté le 17 juillet 2023)
- ↑ (en) Carin F. Gonsalves, Edith P. Mitchell et Daniel B. Brown, « Management of Hypersplenism by Partial Splenic Embolization With Ethylene Vinyl Alcohol Copolymer », American Journal of Roentgenology, vol. 195, no 5, , p. 1241–1244 (ISSN 0361-803X et 1546-3141, DOI 10.2214/AJR.10.4401, lire en ligne)
- ↑ Mariana Lima, Sofia Dutra, Filipe Veloso Gomes et Tiago Bilhim, « Risk Factors for the Development of Postembolization Syndrome after Transarterial Chemoembolization for Hepatocellular Carcinoma Treatment », Acta Medica Portuguesa, vol. 31, no 1, , p. 22–29 (ISSN 1646-0758, PMID 29573765, DOI 10.20344/amp.8976, lire en ligne)
- ↑ 16,0 et 16,1 Adebayo Adeyinka et Khalid Bashir, StatPearls, StatPearls Publishing, (PMID 30085527, lire en ligne)
- ↑ (en) Sabeen Dhand et Ramona Gupta, « Hepatic Transcatheter Arterial Chemoembolization Complicated by Postembolization Syndrome », Seminars in Interventional Radiology, vol. 28, no 02, , p. 207–211 (ISSN 0739-9529 et 1098-8963, PMID 22654264, Central PMCID PMC3193324, DOI 10.1055/s-0031-1280666, lire en ligne)
- ↑ (en) Sid Lee, « Tumour lysis syndrome », sur Canadian Cancer Society (consulté le 17 juillet 2023)