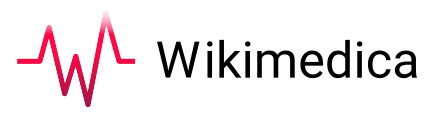ULaval:MED-1203/Flashcards de l'examen 1
Voir les questions de type "choix de réponse"
Voir les questions de type "flashcard"
- Vrai
- Faux
a
C'est un rétrécissement localisé de la lumière aortique.
- Il s'agit d'une sténose localisée de l'aorte
- Elle touche le plus souvent l'aorte ascendante
- Elle entraine un surdéveloppement compensatoire des artères intercostales
- Cliniquement, le patient présente des pouls et une pression artérielle plus élevée dans les membres supérieurs que dans les membres inférieurs
b
- Hypoplasie valvulaire pulmonaire
- Communication interventiculaire
- Dextroposition de l'aorte
- Hypertrophie ventriculaire droite
- Vrai
- Faux
b
C'est un exemple de shunt droite-gauche.
La communication interventriculaire
Communication interventriculaire et communication interauriculaire
- Vrai
- Faux
b
- Vrai
- Faux
a
Le foramen ovale et le canal artériel
Les bourrelets endocardiques
Sinus oblique ou cul-de-sac de Haller
- Tronc artériel
- Bulbus cordis
- Ventricule primitif
- Oreillettes primitives
En cellules endothéliales.
En précurseurs des cellules sanguines
Formation d'agrégats d'hémangioblastes
- 1 )Vasculogenèse
- 2) Constitution du tube cardiaque
- 3) Cloisonnement des oreillettes et formation des canaux auriculoventriculaires
- 4) Cloisonnement des ventricules
- 5) Formation des valves auriculoventriculaires et sigmoïdes
Dans les veines des membres inférieurs.
- Vrai
- Faux
a
- Vrai
- Faux
a
- Tunique externe ou adventice
- Tunique moyenne ou média
- Limitante élastique
- Tunique interne ou intima
- Membrane basale
- Sous-endothélium
- Endothélium
- Vrai
- Faux
a
- Vrai
- Faux
b
Dans la paroi supérieure de l'oreillette droite.
- Fibrosa
- Spongiosa
- Ventricularis
- Actine
- Myosine
- Titine
- Ils sont reliés les uns aux autres par des disques intercalaires
- Le réticulum sarcoplasmique sert de réservoir à calcium
- Les tubules en T sont des invaginations de la membrane cytoplasmique
- Ils ont plusieurs noyaux en périphérie de la cellule
d
Le calcium
Ventricule gauche
Les disques intercalaires et les jonctions communicantes.
- Diminution de la fréquence cardiaque
- Diminution de la contractilité
- Vasoconstriction
- Vrai
- Faux
a
- Augmentation de la fréquence cardiaque
- Augmentation de la contractilité
- Vasodilatation
Parasympathiques et sympathiques
- Endocarde
- Myocarde
- Épicarde
Entre le sommet de l'oreillette droite et la veine cave supérieure.
Le noeud sinusal
- Noeud sinusal
- Noeud auriculoventriculaire
- Faisceau de His
- Fibres de Purkinje
La veine oblique de l'oreillette gauche.
Au niveau des sinus aortiques droit et gauche, aussi appelés sinus coronariens.
La valve mitrale
- Vrai
- Faux
b
Entre le ventricule gauche et l'aorte
L'oreillette gauche et le ventricule gauche.
C'est la valve du foramen ovale
- Vrai
- Faux
b
- Vrai
- Faux
b
Elle est située entre le ventricule droite et le tronc pulmonaire.
Entre l'oreillette droite et le ventricule droit.
- Vrai
- Faux
a
C'est la valve recouvrant l'ostium du sinus coronaire dans l'oreillette droite.
La paroi cardiaque
Entre la veine cave inférieure et l'oreillette droite.
- A. interventriculaire postérieure
- Veine cardiaque moyenne
- A. interventriculaire antérieure
- Grande veine cardiaque
- A. coronaire droite
- Petite veine cardiaque
- Sinus coronaire
- Branche circonflexe de l'a. coronaire gauche
- Vrai
- Faux
b
Artères péricardiacophéniques
- Phrénopéricardique
- Sternopéricardique
- Vertébropéricardique
Sinus transverse ou de Theile
- Elle est lubrifiée par environ 100 ml d'exsudat
- Il s'agit de l'espace entre les couches séreuses pariétale et viscérale du péricarde
- L'incapacité du coeur de se remplir à pleine capacité suite à un épanchement constitue la tamponnade cardiaque
- La tamponnade cardiaque correspond à un choc obstrutif
a
- Vrai
- Faux
a
- Il agit comme voie de circulation collatérale lors d'hypertension portale
- Il permet le retour veineux même lorsqu'une veine cave est obstruée
- La veine hémiazygos est à droite, alors que la veine hémiazygos accessoire est à gauche
- La veine hémiazygos accessoire reçoit le sang provenant des veines bronchiques gauches et des 4e, 5e, 6e, 7e et 8e veines intercostales postérieures gauches
c
Les parois thoracique et abdominale postérieures.
L'aorte thoracique descendante.
Chylothorax
Conduit thoracique
- Vrai
- Faux
a
- Vrai
- Faux
a
Les 2 artères coronaires.
- La dissection de l'aorte ascendante est associée à un bon pronostic
- Le patient ressent habituellement une douleur thoracique dite crucifiante
- Il y a passage de sang artériel entre les couches de l'aorte
- Le traitement pharmacologique est constitué de labétalol et de nitroprussiate de sodium
a
- Elle émerge du ventricule gauche
- Ses trois dilatations forment les sinus aortiques
- L'endroit où l'aorte augmente de calibre est le bulbe aortique
- Elle possède une gaine de péricarde viscéral qui lui est propre
d
Vers le bas, l'arrière et légèrement vers la droite
Innervation motrice et sensitive du diaphragme
- Ils naissent des segments médullaires C6-C7-C8
- Ils passent sur les muscles scalènes antérieurs
- Ils cheminent devant les hiles pulmonaires
- Une lésion d'un nerf phrénique entraine une paralysie de l'hémidiaphragme ipsilatéral
a
- On les appelle aussi nerfs pneumogastriques
- Le nerf laryngé récurrent gauche passe sous l'arc aortique
- Le nerf laryngé récurrent droit passe sous l'artère sous-clavière droite
- Une lésion d'un nerf récurrent laryngé cause une paralysie de la corde vocale controlatérale
d
- Artère carotide commune droite
- Artère sous-clavière droite
- Tronc artériel brachiocéphalique
- Artère carotide commune
- Artère sous-clavière gauche
- L'arc aortique est formé par l'aorte au-dessus de la bronche souche gauche
- Le tronc artériel brachiocéphalique constitue la première branche de l'aorte
- L'aorte traverse le diaphragme par le hiatus aortique
- L'arc aortique est aussi appelé crosse aortique ou aorte transverse
b
La crosse aortique et l'artère pulmonaire gauche.
- Vrai
- Faux
a
- Elles sont formées par les veines jugulaires internes et sous-clavières
- On les appelle aussi veines innominées ou troncs brachiocéphaliques veineux
- La veine brachiocéphalique gauche est plus longue que la droite
- La veine cave supérieure reçoit du sang en provenance du coeur et des poumons
d
Les veines brachiocéphaliques droite et gauche.
- Il est volumineux chez l'adulte
- Il s'agit d'un organe lymphoïde primaire
- Il est le lieu de maturation des lymphocytes T
- Il subit une involution à la puberté
a
Elle diminuera.
Elle augmentera de façon exponentielle.
Elle atteindra le maximum physiologique que la pompe cardiaque est capable de produire.
Dans l'arc aortique et les sinus carotidiens.
Le système nerveux autonome.
Vasodilatation
Vasoconstriction
Les capillaires.
NO (monoxyde d'azote)
- Vrai
- Faux
b
L'autorégulation
- Accélération du métabolisme
- Diminution de la saturation du sang artériel en oxygène
- Foie (27%)
- Reins (22%)
- Cerveau (14%)
- Vrai
- Faux
b
- Positive
- Négative
b
- Positive
- Négative
a
La pression hydrostatique capillaire.
- Vrai
- Faux
a
Il se produit une absorption de liquide à partir du milieu interstitiel vers le capillaire.
Il se produit une filtration de liquide du capillaire vers le milieu interstitiel.
Elle correspond à la somme des 4 forces de Starling.
- Albumine (≈ 80%)
- Globulines (≈ 20%)
- Fibrinogène (négligeable)
Les protéines (du plasma et du liquide interstitiel).
- Vrai
- Faux
a
C'est la pression qui tend à faire sortir le liquide intravasculaire vers le milieu interstitiel par osmose.
C'est la pression qui tend à faire entrer le liquide extravasculaire dans le capilllaire par osmose.
- Vrai
- Faux
a
C'est la pression qui tend à faire entrer le liquide interstitiel dans le capillaire.
C'est la pression qui tend à forcer la sortie du liquide contenu dans le capillaire vers le milieu interstitiel.
- Pression hydrostatique capillaire
- Pression hydrostatique du liquide interstitiel
- Pression oncotique
- Pression colloïde osmotique du milieu interstitiel
- La taille de la molécule
- Sa concentration de part et d'autre de la membrane
La diffusion
La concentration en oxygène à l'intérieur des tissus
64%
- Compétence de la pompe musculo-veineuse
- Pression auriculaire droite
- Résistance du circuit veineux
- Vrai
- Faux
a
- Vrai
- Faux
b
La pompe musculo-veineuse
C'est la pression attribuable au poids du sang en vertu de la gravité.
- Pincement par la première paire de côtes
- Pincement axillaire
- Pression atmosphérique autour des veines du cou
- Pression intra-abdominale
- Pression intra-thoracique à l'expiration
- Vrai
- Faux
a
- Vrai
- Faux
a
- Vrai
- Faux
a
- Vrai
- Faux
a
- Vrai
- Faux
b
En parallèle
- Circulation glomérulaire
- Circulation mésentérique
- Circulation coronaire
- Vrai
- Faux
a
- Vrai
- Faux
a
Diamètre vasculaire
Il existe une relation exponentielle à la puissance 4 entre le débit sanguin et le calibre vasculaire.
- Vrai
- Faux
a
- Vrai
- Faux
b
C'est la capacité d'un vaisseau à laisser écouler le sang lorsqu'il est soumis à un gradient de pression.
- tonus vasomoteur artériolaire
- nombre d'artérioles perfusées
- viscosité sanguine
L'artériole
- Vrai
- Faux
b
La valve tricuspide.
C'est la quantité de sang que les tissus reçoivent par minute.
4 à 7X
- Vrai
- Faux
a
- Le gradient de pression
- La résistance vasculaire
- Vrai
- Faux
b
- Vrai
- Faux
a
- Vrai
- Faux
b
- Vrai
- Faux
a
Les artères distributrices (ex: artères coronaires).
Les artères conductrices (ex : aorte)
Le débit cardiaque
Volume sanguin dans le ventricule à la fin de la diastole.
Les 2 augmentent.
La contractilité diminue et la fréquence cardiaque aussi.
- Vrai
- Faux
a
- Vrai
- Faux
a
- Diminution de la fréquence cardiaque (principalement)
- Faible diminution de la contractilité
Adrénaline et noradrénaline
- Vrai
- Faux
a
- Augmentation du débit cardiaque
- Majoration de la contractilité
- Majoration de la fréquence cardiaque
- Augmentation de la capacité de relaxation myocardique
- Volume télédiastolique : aucun effet
- Pression intraventriculaire systolique : augmentation
- Pression intraventriculaire diastolique : aucun effet
- Volume télésystolique : diminution
- Volume télédiastolique : aucun effet
- Pression intraventriculaire systolique : augmentation
- Pression intraventriculaire diastolique : aucun effet
- Volume télésystolique : augmentation
- Volume télédiastolique : augmentation
- Pressions : augmentation
- Volume télésystolique : légèrement augmenté
- Dimension ventriculaire
- Compression péricardique ou extrinsèque
- Élasticité des fibres myocardiques
- Vrai
- Faux
a
C'est la capacité des ventricules à se distendre lorsque la pression intraventriculaire augmente au cours du remplissage.
- Vrai
- Faux
a
- Relaxation ventriculaire
- Compliance ventriculaire
- Stimulation nerveuse sympathique
- Sécrétion de catécholamines
- Calcémie
- Hypoxie, hypercapnie et acidose
- Ischémie myocardique, mort cellulaire et fibrose myocardique
- Remodelage ventriculaire
- Cardiomyopathie hypertrophique
- Fréquence cardiaque
- Vrai
- Faux
b
Elle représente la force de contraction intrinsèque du muscle cardiaque et sa capacité à pomper le sang dans le système circulatoire.
La pression artérielle systolique
- Vrai
- Faux
a
C'est la charge contre laquelle le muscle cardiaque exerce sa force contractile.
C'est le degré de tension exercé sur le muscle cardiaque tout juste avant la contraction.
- Vrai
- Faux
a
- Vrai
- Faux
b
- Vrai
- Faux
a
Le volume d'éjection généré sera plus grand.
- Vrai
- Faux
a
Loi de Frank-Starling
On peut entendre un B3.
C'est le sang résiduel dans le ventricule gauche après la systole.
150 à 170 ml
- Vrai
- Faux
a
- Vrai
- Faux
b
- Vrai
- Faux
a
- Ils permettent aux valves sigmoïdes de rester fermées durant la diastole.
- Ils permettent aux valves auriculoventriculaires de ne pas faire de prolapsus vers les oreillettes lors de la systole.
- Ils permettent aux valves auriculoventriculaires de bien rester fermées durant la systole.
b
Les muscles papillaires ne jouent aucun rôle dans la fermeture des valves AV.
Les valves sigmoïdes ne sont pas reliées à des muscles papillaires.- Vrai
- Faux
a
- Vrai
- Faux
b
Diastole
- Vrai
- Faux
b
- Vrai
- Faux
a
- Vrai
- Faux
a
Durant la phase de remplissage rapide, lorsque la pression intra-auriculaire dépasse la pression intra-ventriculaire.
- Vrai
- Faux
b
- Vrai
- Faux
a
Fermeture des valves sigmoïdes (lors de la relaxation isovolumétrique en début de diastole).
- Relaxation isovolumétrique
- Remplissage rapide
- Remplissage lent
- Contraction auriculaire
- Vrai
- Faux
a
- Vrai
- Faux
a
Fermeture des valves auriculoventriculaires durant la systole.
- Vrai
- Faux
a
- Contraction isovolumétrique
- Phase d'éjection
- Diastole
- Systole
b
- Diastole
- Systole
a
La diminution de la concentration intracellulaire de calcium et la dissociation des ions calciques de la troponine C.
La liaison d'ions calciques à la troponine C.
Maintenir en place la tropomyosine sur les sites actifs de l'actine.
Bloquer les sites actifs du filament d'actine pour empêcher la myosine de s'y lier et d'initier la contraction.
L'ATP et le calcium
- Vrai
- Faux
b
L'actine et la myosine
La propagation du potentiel d'action en assurant la diffusion rapide des ions.
Unir intimement les cellules musculaires cardiaques
Disques intercalaires
Les mucopolysaccharides chargés négativement.
- 6
- 9
- 12
- 15
c
Le bloc auriculoventriculaire est un délai mineur de la conduction entre les oreillettes et les ventricules. Il se traduit à l’électrocardiogramme par un intervalle PR supérieur ou égal à 0,20 seconde.
Un QRS large, c’est-à-dire de plus de 120 msec, associé à un rythme supraventriculaire peut indiquer la présence d’un bloc de branche ou d’un trouble de conduction intraventriculaire non spécifique.
La durée normale du complexe QRS est de 80 à 120 msec, soit de 2 à 3 mm.
Le complexe QRS correspond à la dépolarisation des ventricules.
L’intervalle PR est compris entre 120 et 200 msec, c’est-à-dire 3 à 5 mm.
- Vrai
- Faux
b
Augmentation de l'excitabilité cardiaque
Augmentation de la force de contraction
Ralentissement de la conduction dans le nœud auriculoventriculaire
Si le rythme est irrégulier, il est important de s’assurer au préalable qu’il s’agit bien d’un électrocardiogramme de 10 secondes, car la durée de l’enregistrement influence le nombre de complexes QRS présents sur la bande de rythme. Si l’électrocardiogramme dure bien 10 secondes, il suffit de multiplier par 6 le nombre de complexes QRS présents sur la bande de rythme afin d’obtenir la fréquence cardiaque en battements par minute.
Pour un ECG de 10 secondes : FC = Nombre de QRS x 6
Pour un ECG de 12 secondes : FC = Nombre de QRS x 5
Faux
V1, V2, V3, V4, V5 et V6
D1-D2-D3-aVF-aVR-aVL
Vrai
La période réfractaire totale (PRT) correspond à l’addition des périodes réfractaires absolue et relative.
La période réfractaire relative (PRR) succède à la période réfractaire absolue et se poursuit jusqu’à la fin de la repolarisation terminale. Durant cette période, la cellule cardiaque redevient excitable par des stimuli de fréquence élevée ou de grande intensité.
La période réfractaire absolue (PRA) est un intervalle de temps pendant lequel la cellule cardiaque ne produit pas de potentiel d’action et ce, peu importe la fréquence et l’intensité des stimuli.
Les périodes réfractaires
Vrai
La fréquence cardiaque physiologique est égale à celle du nœud sinusal.
Vrai
Lente
Rapide
Le seuil d’excitation correspond à la différence de potentiel membranaire à partir de laquelle un potentiel d’action est invariablement généré.
- Vrai
- Faux
a
Vrai
Faux
Vrai
Le potentiel d’action se divise en cinq phases successives, soit les phases de repos, de dépolarisation, de repolarisation rapide précoce, de plateau et de repolarisation terminale.
Le sodium (Na+) et le potassium (K+)
2
Faux
Faux
Le nœud auriculoventriculaire est situé dans le septum auriculoventriculaire au niveau de l’insertion du feuillet septal de la valve tricuspide.
Diminuer la vitesse de conduction de l’impulsion électrique en provenance du nœud sinusal et des faisceaux internodaux.
Le nœud sinusal
Assurer la transmission de l’impulsion électrique de l’oreillette droite vers l’oreillette gauche
3
Dans la paroi de l’oreillette droite, à la jonction entre le sommet de l’oreillette et la veine cave supérieure.
Commander le rythme cardiaque.
Les cellules cardionectrices
- Vrai
- Faux
a
L'obésité.
C'est l'accumulation de graisses au niveau des hanches, des fesses et des cuisses. Elle est typique chez la femme.
C'est l'accumulation de graisses dans la cavité abdominale. Elle est typique chez l'homme.
- Vrai
- Faux
a
C'est une condition fréquente qui est caractérisée par un ensemble d'anomalies métaboliques: obésité androïde, hypertension artérielle, dyslipidémie, profil inflammatoire chronique et hyperglycémie chronique.
- Obésité androïde
- Obésité gynécoïde
a
- Vrai
- Faux
b
À cause de leur taux sérique d’œstrogènes élevé.
- Homme = 40 ans
- Femme = 45 ans
- Âge
- Sexe
- Hérédité
- Hyperlipidémie
- Tabagisme
- Hypertension artérielle
- Diabète
- Obésité androïde
- Facteurs psychosociaux (stress, dépression)
- Nutrition riche en gras et pauvre en fruits et légumes
- Sédentarité
- Alcool
- Personnalité de type A
L'infarctus du myocarde.
Dans les pays en voie de développement.
- Vrai
- Faux
b
Durant la période des maladies dégénératives et induites par l'homme.
- Valvulopathies rhumatismales
- Hypertension artérielle
- Maladie coronarienne athérosclérotique
- AVC
L'exode de la population des milieux ruraux vers les villes (conséquence de l'industrialisation).
- Période de la peste et de la famine
- Période des grandes pandémies
- Période des maladies dégénératives et induites par l'homme
- Période du déclin des maladies dégénératives et induites par l'homme
- Période des complications de l'obésité
Environ 24%
- Diabète
- Maladie rénale chronique
- Vrai
- Faux
a
Lorsque la TAS est supérieure à 20 mm Hg ou lorsque la TAD est supérieure à 10 mm Hg de la valeur cible.
- Vrai
- Faux
a
- Insuffisance rénale
- Toux sèche
- Angioedème
- Hyperkaliémie
- Insuffisance cardiaque
- Dysfonction systolique
- Antécédents d'infarctus du myocarde
- Diabète
- Maladie rénale chronique avec protéinurie
- Vrai
- Faux
a
- Vrai
- Faux
b
On utilise les diurétiques thiazidiques dans le traitement de l'HTA, alors que les diurétiques de l'anse son utilisés dans les maladies rénales chroniques ou l'insuffisance cardiaque.
- Vrai
- Faux
a
- Bêta-bloqueurs
- Tous les BCC
- IECA, ARA et IDR
- Alpha-bloqueurs
- Agonistes alpha-2 centraux
- Diurétiques
- Agents sympathicolytiques
- Vasodilatateurs directs
- Bêta-bloqueurs
- BCC non dihydropyridiniques
- Vrai
- Faux
a
- Insuffisance vasculaire cérébrale
- Encéphalopathie
- Thrombose cérébrale
- Hémorragie intracrânienne
- Hémorragie sous-arachnoïdienne secondaire à une rupture d'anévrysme
- Vrai
- Faux
a
L'hypertension artérielle est une cause de micro-infarctus du parenchyme cérébral.
- Diastolique
- Systolique
a
Un fond d'oeil.
- 1) Spasme vasculaire
- 2) Sclérose vasculaire
- 3) Hémorragie et exsudats
- 4) Papilloedème
La rétinopathie hypertensive.
- FSC
- Bilan ionique
- Créatinémie et DFG
- Glycémie
- Bilan lipidique
- Sommaire et microscopie des urines
- ECG
- Vrai
- Faux
b
Elle est plus souvent asymptomatique.
- HTA sévère ou réfractaire
- Perte de contrôle de la pression artérielle chez un patient auparavant bien contrôlé
- HTA débutant avant la puberté
- Détérioration spontanée de la fonction rénale
- Détérioration de la fonction rénale après l'administration d'IECA ou d'ARA
- Souffle systolo-diastolique abdominal
- Asymétrie rénale
- Absence d'histoire familiale d'HTA
- Présence de signes ou de symptômes spécifiques suggestifs d'une cause secondaire
- AINS
- Oestrogènes
- Stéroïdes
- Sympathicomimétiques
- Antidépresseurs tricycliques
- Inhibiteurs de la monoamine oxydase
- Cyclosporine
- Érythropoïétine
- Cocaïne
- Hypothyroïdie
- Hyperthyroïdie
- Hyperparathyroïdie
- Hypercalcémie
- Acromégalie
- Hyperaldostéronisme primaire
- Syndrome de Cushing
- Phéochromocytome
- Certaines déficiences enzymatiques
- Maladies parenchymateuses
- Kystes rénaux
- Tumeurs rénales
- Uropathie obstructive
- Vrai
- Faux
a
Chez les individus noirs, l'hypertension apparaît à un plus jeune âge.
Perte d'élasticité des gros vaisseaux.
Vasoconstriction périphérique
- Vrai
- Faux
b
L'hypertension primaire compte pour 95% des cas alors que l'hypertension secondaire compte pour seulement 5% des cas.
Une TAS > 140 mm Hg et/ou une TAD > 90 mm Hg
- Vrai
- Faux
a
Le syndrome de la blouse blanche (white coat hypertension).
La pression artérielle est déterminée par l'auscultation des bruits générés par le flot sanguin lorsque la pression générée par le brassard préalablement gonflé est relâchée. Ces 5 bruits auscultatoires portent ce nom.
Régurgitation aortique sévère
La disparition complète des bruits.
La pression artérielle diastolique.
- Vrai
- Faux
b
Ils n'ont aucune signification clinique.
La pression artérielle systolique.
- Vrai
- Faux
b
C'est un facteur prédictif majeur de la mortalité associée à un AVC, c'est-à-dire que plus la tension artérielle est élevée, plus le risque de mourir lorsqu'on fait un AVC est élevé.
- Vrai
- Faux
a
140/90 mmHg
- Vrai
- Faux
a
La tension artérielle systolique.
La tension artérielle diastolique.
- Vrai
- Faux
a
Aortique et mitrale
Lorsque les cuspides d’une valve ne se ferme plus de façon étanche donc il y a un reflux de sang. C’est un jeu de pression; le sang va où il y a moins de pression.
- Insuffisance mitrale : Reflux de sang lors de la systole, le ventricule gauche envoie du sang dans l’aorte, mais aussi dans l’oreillette gauche
- Insuffisance aortique : Reflux du sang lors de la diastole, le ventricule gauche se fait remplir par le sang provenant de l’oreillette gauche, mais aussi par du sang provenant de l’aorte
Lorsqu’il y a une obstruction au passage du sang, ce qui engendre une congestion au niveau de l’oreillette (sténose mitrale) ou du ventricule (sténose aortique).
- Valvulaire
- Anomalies congénitales --> Bicuspidie aortique
- Rhumatisme articulaire aigu (RAA) ** Peut aussi mener à la sténose **
- Endocardites infectieuses
- Sclérose (Calcifications dégénératives)
- Connectivites
- Prolapsus valvulaire
- Rupture de cuspide
- Secondaires à une maladie de l’aorte
- Dissection aortique ** La dissection peut se rendre jusqu’à la valve**
- Syndrome de Marfan (Maladie génétique)
- Extasie annulo-aortique (Dilatation de l’anneau aortique et de l’aorte ascendante)
- HTA sévère
- Aortites
- Traumatisme
- Vrai
- Faux
a
Tension des fibres myocardiaques = (Pression Intra-Ventriculaire x Rayon cavité ventriculaire)/ Épaisseur de la paroi myocardique
- Tension de paroi est proportionnelle à la Pression intra-cavitaire
- Tension de paroi est proportionnelle au Rayon intra-cavitaire
- Tension de paroi est inversement proportionnelle à l'Épaisseur de la paroi
- Aiguë
- Chronique compensée
- Chronique décompensée
- a) et b)
- Toute ces réponses
a
C’est seulement lors d’une insuffisance aortique AIGUË que la compliance du VG demeure inchangée puisque le ventricule n’a pas le temps de réagir/de se remodeler (ces dimensions demeurent normales).
Lors d'une insuffisance aortique CHRONIQUE, la compliance augmente en raison de la dilatation ventriculaire pour compenser l'augmentation du volume de sang dans le ventricule. En chronique décompensé, la compliance du VG est donc maximale.
RAPPEL : La compliance correspond à la capacité des ventricules à se distendre lorsque la Pression intra-ventriculaire augmente au cours du remplissage Elle est influencé par :
- Dimensions ventriculaires
- Dilation ventriculaire = Augmentation de la compliance
- Compression péricardique (force extrinsèque exercée sur le cœur)
- Augmentation de la Pression de remplissage => Diminution de la compliance
- Élasticité des fibres myocardiques
- Diminution de l'Élasticité (fibrose, hypertrophie…) => Diminution de la compliance
- Aiguë : La pression diastolique du VG augmente car la compliance ventriculaire est normale et le volume de sang est plus important.
- Chronique compensée : La pression diastolique du VG est normale, l’augmentation de la compliance contrebalance l’augmentation du volume sanguin.
- Chronique décompensée : La pression diastolique du VG augmente, le retour de sang est trop important, l’augmentation de la compliance n’est plus suffisante.
L’insuffisance aortique chronique compensée
Puisque c'est dans celle-ci que le volume d’éjection est le plus augmenté, cela crée un grand différentiel de pression. Il y a donc davantage de sang qui revient au niveau du ventricule gauche lors de la diastole. Par conséquent, on mesure une tension artérielle systolique élevée et une tension artérielle diastolique basse.
Pour l’insuffisance aortique aiguë et chronique décompensée, le volume de régurgitation est aussi augmenté, mais moins qu'en compensée puisque l’augmentation du volume d’éjection est moindre. Le différentiel de pression est donc moindre, ce qui résulte en un plus petit retour de sang. Par conséquent, la pression artérielle diastolique demeure normale.- B1 normale
- Souffle d’éjection systolique (crescendo-decrescendo) immédiatement après B1
- Dû au gros volume de sang propulsé par le ventricule
- B2 normal
- Peut être diminué voir absent dans les cas sévères
- Souffle diastolique (decrescendo) immédiatement après B2
- Dû à la régurgitation
- B3 possible : Sang provenant de l’oreillette rencontre un volume restant dans le ventricule
Les sons sont souvent mieux entendus en para-sternal gauche.
- Angine
- Dyspnée d’effort reliée à la régurgitation
- Fraction d’éjection < 55%
- Dilatation significative du VG
- Dilatation significative de l’aorte
- Urgence si aiguë et mal tolérée (risque de choc cardiogénique)
- Irrégulièrement irrégulier
- Pulsus parvis tardes
- Pouls Water-hammer
- Pouls est normal
c
Le pouls water-hammer a une montée rapide, une grande amplitude et une descente brutale en raison du volume d'éjection élevé et du retour du sang qui cause la descente rapide.
A: Associé à la sténose mitrale (peut être dû à la FA)
B: Associé à la sténose aortique : C'est un pouls avec montée lente et une amplitude maximale réduite et retardée- Valvulaire
- Sous-valvulaire
- Supra-valvulaire
a
- Bicuspidie
- RAA
- Sclérose
- Extasie anulo-aortique
- HTA sévère
- a), b) et c)
- Toutes ces réponses
f
- HTA
- Obésité
- Coarctation de l'aorte
- Endocardite infectieuse
- a) et b)
- c) et d)
- Toutes ces réponses
f
- Dyspnée, Angine, Syncope
- Dyspnée, Étourdissement, Fatigue
- Angine, HTA, Fatigue
a
- B4
- B1 normal
- Claquement d’éjection
- Souffle d’éjection (crescendo-decrescendo) qui s’étend de B1 à B2
- Plus la sténose est sévère, plus le maximum du souffle est tardif
- B2 diminué
- Peut se dédoubler paradoxalement ou devenir absent = Sévérité
Le B4 témoigne de l’Hypertrophie et de la perte de compliance du VG (Sténose sévère)
Le claquement d'éjection est dû à l'ouverture de la valve sténose encore mobile (absent chez le patient âgé)- Absent
- Étallé
- Déplacé vers la gauche
- b) et c)
b
- Muscles papillaires
- Cordages tendineux
- Feuillets mitraux
- Anneau mitral
- Ventricule gauche
- Valvulaire
- Prolapsus mitral
- Dégénérescence myxomateuse
- Endocardite
- RAA
- Ventriculaire
- IDM
- Cardiomyopathie dilatée
- Fibrillation auriculaire (FA)
- Insuffisance cardiaque gauche (ICG)
- Insuffisance cardiaque droite (ICD)
La fibrillation auriculaire est due à la surcharge de volume qui cause une dilatation de l'oreillette gauche. Voici les symptômes associés à chacun :
- FA : Palpitations
- ICG : Dyspnée, Fatigue, Orthopnée (en raison de l'oedème pulmonaire)
- ICD : Oedème périphérique, distension des jugulaires, hépatomégalie, hépatalgie, ascite...
- Fatigue, Orthopnée et Dyspnée d'effort
- Angine et Étourdissement
- Dyspnée, Angine et Syncope
a
- B1 diminué
- Souffle holosystolique (constant durant toute la période entre B1 et B2)
- B2 normal
- Mais peut augmenter et se dédoubler largement en cas d’hypertension pulmonaire
- B3 « Sang contre sang »
- Roulement diastolique : Provoqué par l’augmentation du flux à travers la valve (pas tjs là)
Un parmi :
- NYHA 3 ou 4
- Fraction d'éjection < 60%
- Dimension du VG en télésystole > 45mm
- La prévalence de la bicuspidie aortique
- La prévalence du RAA
- L'âge
- Le poids
b
- Oreillette droite
- Ventricule droite
- Circulation pulmonaire
- Oreillette gauche
- Ventricule gauche
- a), b), c) et d)
- Toutes ces réponses
f
- Pas d'impact
- Améliore la situation
- Exacerbe les symptômes, mais sans danger
- Exacerbe les symptômes et très dangereux
d
- B1 fort (si valve mitrale encore mobile, sinon B1 est diminué, ex lorsque valve très calcifiée)
- B2 normal (augmenté si HTP)
- Claquement d’ouverture
- Souffle mésodiastolique decrescendo-crescendo « roulement »
- Causé par la turbulence du flot sanguin à travers l’orifice mitral
- Régurgitation sévère associée
- Classe NYHA III ou IV
- HTP sévère (> 80mmHg)
- Électrocardiogramme
- Radiographie pulmonaire
- Échocardiographie
c
- Métalliques
- Biologiques
- Les prothèses biologiques ont une longévité plus longue que les métalliques.
- Les prothèses métalliques ne nécessitent pas d’anticoagulothérapie.
- Les prothèses métalliques sont peu fiables.
- Une prothèse métallique n’est pas contre-indiqué en cas antécédent d’hémorragie cérébrale.
- L’HTA, l’hypercalcémie et le diabète mal contrôlé peuvent accélérer la dégradation de prothèses biologiques.
e
- a) Longévité des métallique (~25 ans) > Longévité des biologiques (15-20 ans)
- b) Ce sont les prothèses biologiques qui ne nécessitent pas d’anticoagulothérapie. Pour les métalliques, elle est nécessaire à vie.
- c) Elles sont très fiables.
- d) Elles sont contre-indiqué en cas d’ATCD d’hémorragie cérébrale en raison de la nécessité d’une anticoagulothérapie.
- Vrai
- Faux
b
Les beta-bloqueurs sélectifs ont plus d'affinité avec les récepteurs beta 1. C'est pourquoi on dit qu'ils sont cardiosélectifs.
- Arythmies
- Prévention secondaire de l'ischémie (Post-infarctus)
- Insuffisance cardiaque instable ou mal contrôlée
- Angine
- Hypertension artérielle
c
L'utilisation de beta-bloqueurs est contre-indiquée en insuffisance cardiaque instable, mais est essentiel au traitement de l'insuffisance cardiaque stable.
L'autre contre-indication principale est l'asthme.- Récepteurs beta 1
- Récepteurs beta 2
b
- Vrai
- Faux
a
À faible dose, ils réduisent le risque de bronchoconstriction et de vasodilatation et sont donc plus sécuritaires pour ce type de patient.
Au repos, ils ont tendance à stimuler partiellement les récepteurs beta au lieu de les inhiber. La fréquence cardiaque au repos se retrouve alors à être diminuée moindrement qu'avec les beta-bloqueurs ordinaires. Ce phénomène disparaît à l'effort et ils sont donc aussi efficaces que les autres beta-bloqueurs.
- Vrai
- Faux
b
Leur efficacité est maximale lorsque l'activité sympathique est élevée. C'est le cas lors d'un effort intense.
- Effet inotrope négatif (diminution de la contractilité)
- Effet chronotrope négatif (diminution de la fréquence cardiaque)
- Effet dromotrope négatif (diminution de la conduction au niveau des oreillettes et allongement de la période réfractaire au noeud auriculoventriculaire)
- Certains beta-bloqueurs favorisent la vasodilatation périphérique.
- Leur effet chronotrope et inotrope négatifs entraînent une diminution du débit cardiaque.
- Certains beta-bloqueurs ont un effet de vasodilatation périphérique, ce qui diminue la résistance vasculaire périphérique.
Ces deux phénomènes aident à diminuer la tension artérielle.
- Effet dromotrope négatif : ralentissement de la conduction dans l'oreillette
- Rallonge la période réfractaire du noeud AV
Leurs multiples effets sur le coeur causent une diminution des besoins myocardiques en oxygène et autres nutriments. Le coeur est ainsi moins à risque d'ischémie.
Ils agissent sur les cellules musculaires lisses au niveau des parois vasculaires et provoquent une vasodilatation. Ils diminuent donc la résistance vasculaire périphérique, et ainsi la tension artérielle.
- Prévention secondaire post-infarctus
- Arythmie
- Hypertension artérielle
- Angine
- Insuffisance cardiaque instable
c
- Grossesse
- Bloc auriculoventriculaire
- Insuffisance cardiaque instable
- Maladie pulmonaire obstructive sévère (MPOC ou Asthme)
- Maladie vasculaire périphérique
- Aucune de ces réponses
f
- Vrai
- Faux
a
- Ils stimulent les récepteurs pré-synaptiques alpha 2, causant une diminution de la libération de noradrénaline.
- Ils provoquent une baisse de la résistance périphérique totale, et donc une diminution de la tension artérielle.
- Ils ont aussi un effet chronotrope négatif, ce qui réduit la fréquence et le débit cardiaque.
- AT1
- AT2
a
- Vrai
- Faux
b
Les IECA peuvent causer de la toux par accumulation de bradykinines. Par contre, les ARA ne provoquent pas de toux.
- Hypertension artérielle
- Prévention du remodelage ventriculaire
- Néphropathie diabétique
- Angioedème
- Insuffisance cardiaque
- Post-infarctus
- Prévention d'événements cardiaques
d
Un antécédent d'angioedème est une contre-indication à l'utilisation d'IECA, puisque c'est un des effets secondaires de celui-ci.
(L'angioedème est un oedème sous-cutané qui touche surtout le visage et les voies respiratoires. Cette situation peut donc être fatale.)- Vrai
- Faux
b
La grossesse est une contre-indication absolue.
- Insuffisance cardiaque
- Hypertension artérielle.
Noter que les diurétiques sont utiles dans plusieurs autres conditions, mais celles-ci sont les principales.
On utilise de préférence les diurétiques de l'anse de Henle pour le traitement de l'insuffisance cardiaque, alors que les diurétiques thiazidiques sont préférés pour le traitement de l'HTA.Les diurétiques osmotiques
Les autres diurétiques entravent la réabsorption de sodium au niveau rénal, et empêche donc également la réabsorption d'eau.
Les diurétiques osmotiques créent un appel d'eau dans le tubule, et augmentent ainsi l'excrétion urinaire d'eau, sans agir directement sur l'absorption du sodium.- Tubule proximal
- Anse de Henle
- Tubule distal
- Tubule collecteur
a
- Tubule proximal
- Anse de Henle
- Tubule distal
- Tubule collecteur
a
- Tubule proximal
- Anse de Henle
- Tubule distal
- Tubule collecteur
b
- Tubule proximal
- Anse de Henle
- Tubule distal
- Tubule collecteur
c
- Tubule proximal
- Anse de Henle
- Tubule distal
- Tubule collecteur
d
- Spironolactone (Préservateur de potassium)
- Acétazolamide (Inhibiteur de l'anhydrase carbonique)
- Furosémide (Diurétique de l'anse)
- Mannitol (Diurétique osmotique)
- Hydrochlorothiazide (diurétique thiazidique)
- Mannitol (le plus faible)
- Acétazolamide
- Spironolactone
- Hydrochlorothiazide
- Furosémide (le plus puissant)
Les diurétiques de l'anse de Henle (Furosémide).
Les diurétiques thiazidiques (Hydrochlorothiazide).
Les diurétiques préservateurs de potassium.
C'est un antagoniste compétitif de l'aldostérone au niveau du tubule collecteur. Il diminue la SYNTHÈSE de canaux sodiques et de pompes Na+K+ ATPases. La spironolactone diffère ainsi des autres diurétiques épargneurs de potassium (Triamtérène et Amilodarone) qui inhibent les canaux sodiques.
- Diurétique osmotique
- Inhibiteur de l'anhydrase carbonique
- Diurétique de l'anse de Henle
- Diurétique thiazidique
- Diurétique épargneur de potassium
a
Les diurétiques osmotiques ont une activité faible et ne sont pas utilisés.
Les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique sont également faibles, et sont donc rarement utilisés.- Canaux calciques voltages-dépendants (canaux lents).
- On les retrouve au niveau du muscle cardiaque, du nœud sinusal, du nœud auriculo-ventriculaire et des muscles lisses de la paroi vasculaire.
- Dihydropyridines
- Benzothiazépines
- Phénylalkylamines
- Vrai
- Faux
b
Les dihydropyridines sont de puissants vasodilatateurs. Les non-dihydropyridiniques ont des propriétés vasodilatatrices moindres.
- Vasodilatation des artères périphériques.
- Augmentation de la fréquence cardiaque et du débit cardiaque par stimulation sympathique réflexe.
- Ralentissement de la conduction nodale auriculo-ventriculaire (au nœud sinusal et au nœud auriculo-ventriculaire)
- Réduction de l'automaticité cardiaque (diminution de la fréquence cardiaque)
- Allonge la période réfractaire
- Propriétés vasodilatatrices faibles
- Hypertension artérielle
- Angine
- Arythmies (les non-dihydropyridiniques seulement)
- Vasodilatation des artères coronaires : augmentation de l'apport sanguin dans la région ischémique du myocarde.
- Vasodilatation des artères périphériques : diminution de la postcharge, et donc diminution des besoins en oxygène du myocarde.
- Ralentissement du rythme cardiaque (pour les non-dihydropyridiniques seulement) : réduction de la demande du coeur en oxygène.
La vasodilatation des artères périphériques provoque une diminution de la résistance vasculaire périphérique, ce qui fait diminuer la tension artérielle.
- Vrai
- Faux
a
- Vrai
- Faux
a
Ils doivent perdre leur radical nitrate pour devenir actifs et ainsi exercer leurs effets thérapeutiques.
Le monoxyde d'azote (NO).
- Soulagement rapide des symptômes de l'angine
- Traitement prophylactique des crises angineuses (prévenir les crises lors de situations susceptibles d'en déclencher)
- Vasodilatation des veines capacitatives : les veines peuvent emmagasiner une certaine quantité de sang, ce qui diminue la quantité de sang arrivant au coeur (la pré-charge).
- Vasodilatation des artères systémiques : Réduction de la postcharge.
- Vasodilatation des artères coronaires : Augmentation l'apport sanguin dans les régions ischémiques du coeur.
- Nitroglycérine
- Isosorbide mononitrate
- Vrai
- Faux
b
Faux
Les dérivés nitrés perdent leur efficacité anti-angineuse lors d'une utilisation répétée (phénomène de tolérance). Nous observons ce phénomène surtout avec les nitrates organiques à longue action.
- Vrai
- Faux
b
Les nitrates organiques à longue action sont contre-indiqués avec les inhibiteurs de la PDE-5 (qui sont aussi des vasodilatateurs).
- Vrai
- Faux
b
L'aspirine agit de manière irréversible, alors que les autres AINS inhibent la COX-1 et/ou COX-2 de façon réversible.
- Analgésique (soulagement de la douleur)
- Antipyrétique (réduction de la fièvre)
- Anti-inflammatoire
- Inhibiteur de l'agrégation plaquettaire
Acide acétylsalicylique (AAS)
- Allergie / Hypersensibilité
- Asthme sévère
- Trouble plaquettaire
- Saignement actif
Il existe d'autres contre-indications, par exemple :
- Dernier trimestre de grossesse
- Ulcère gastro-intestinal aigu
- Insuffisance rénale, hépatique ou cardiaque grave
- Vrai
- Faux
a
- Antagoniste de la vitamine K
- Inhibiteur direct de la thrombine
- Inhibiteur direct du facteur Xa
- Antagoniste des récepteurs de l'ADP
- Antagoniste des récepteurs GpIIb/IIIa
d
- Vrai
- Faux
a
Il doit subir une bioactivation par le cytochrome P450.
- Vrai
- Faux
b
Faux
Le Clopidogrel, lorsqu'activé par le cytochrome P450, inhibe la liaison de l'ADP au P2Y12 de façon irréversible. Cette inhibition persiste ainsi toute la durée de vie des plaquettes (7-10 jours).
Comme leur nom l'indique, ils se lient aux récepteurs GpIIb/IIIa, ce qui empêche le fibrinogène et le facteur von Willebrand de se lier aux plaquettes et de favoriser leur agrégation.
- Abciximab
- Eptifibatide
- Tirofiban
Elle se lie de manière réversible et active l'antithrombine III. Ce complexe inhibe le facteur IIa (la thrombine) et le facteur Xa. Le facteur Xa est responsable du clivage de la prothrombine en thrombine.
- Héparine non fractionnée (HNF)
- Héparine de bas poids moléculaire (HBPM)
a
Tout comme l'héparine non fractionnée, l'HBPM se lie de façon réversible à l'antithrombine III et l'active. Toutefois, ce complexe va seulement inhiber le facteur Xa (qui clive la prothrombine en thrombine), et pas le facteur IIa (la thrombine).
- Sous-cutanée
- Intraveineuse
Pour dépister la thrombopénie induite par l'héparine (TIH).
- Vrai
- Faux
a
Ils inhibent de manière compétitive le facteur IIa (la thrombine), et agissent ainsi sur la voie commune de la coagulation. En inhibant la thrombine, ces médicaments empêchent la transformation du fibrinogène en fibrine, et préviennent donc la formation de thrombus.
Ils inhibent le facteur Xa et empêchent ainsi le clivage de la prothrombine en thrombine. Ils agissent sur la voie intrinsèque de la coagulation.
- Vrai
- Faux
b
L'héparine prévient la progression du caillot déjà existant, mais elle n'agit pas directement sur sa lyse.
- Vrai
- Faux
b
Faux
La warfarine est un antagoniste de la vitamine K.
- Cette classe d'anticoagulant inhibe la voie extrinsèque de la coagulation en empêchant la synthèse hépatique de certains facteurs de coagulation dépendants de la vitamine K : les facteurs II (prothrombine), VII, IX et X.
- Sous-cutanée
- Intraveineuse
- Orale
c
- Grossesse
- Risque hémorragique / saignement actif
Ils transforment le plasminogène en plasmine, ce qui dégrade la fibrine des caillots.
Dans un contexte d'infarctus du myocarde, dans le but de dégrader un caillot logé dans une artère coronaire.
L'hémorragie