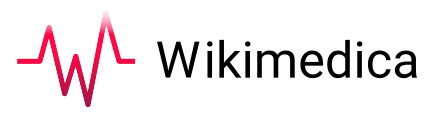Trouble lié à l'usage de l'alcool
| Maladie | |||
 Formule chimique de l'éthanol | |||
| Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|
| Signes | |||
| Symptômes |
Paresthésies, Humeur dépressive, Dysfonction érectile, Nausées, Tentative de suicide, Perte d'emploi, Amnésie, Hématémèse, Antécédents, Sevrage à l'alcool, ... [+] | ||
| Diagnostic différentiel |
Troubles de l'humeur, Troubles anxieux, Consommation non pathologique d'alcool, Trouble de l'usage des sédatifs, Trouble de l'usage des hypnotiques, Trouble de l'usage des anxiolytiques, Auto-médication | ||
| Informations | |||
| Terme anglais | Alcohol use disorder | ||
| Autres noms | Alcoolisme, éthylisme, alcoolodépendance, abus d'alcool | ||
| Wikidata ID | Q15326 | ||
| Spécialités | Psychiatrie, Toxicologie, Médecine familiale, Médecine interne | ||
| |||
Le trouble lié à l'usage de l'alcool (TUA) se définit comme un mode de consommation problématique de l'alcool et qui est associé à des symptômes cognitifs, comportementaux et physiologiques entraînant la perte de contrôle de l'individu sur sa consommation d'alcool. Enfin, une souffrance et/ou un dysfonctionnement social découle de la consommation de l'alcool.[1][2]
Épidémiologie
Selon l’enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues (ECTAD) de 2019, effectuée auprès de plus de 10 000 Canadiens de 15 ans et plus, 76% des répondants ont déclaré avoir consommé de l'alcool au cours de la dernière année, avec une prévalence légèrement supérieure auprès des hommes. Elle se décline de la façon suivante selon les groupes d'âge : 49% chez les 15-19 ans, 84% chez les 20-24 ans et 78% chez les plus de 25 ans. C'est toutefois au Québec que la prévalence de consommation est la plus élevée, atteignant 81% des répondants, en légère baisse par rapport à la dernière enquête de 2017.[3]
Des individus ayant consommé de l'alcool, c'est près du quart d'entre-eux (23%) qui ont dépassé les directives de consommation afin de prévenir les effets aigus et/ou chroniques de la consommation d'alcool. Ce sont finalement 21% des consommateurs d'alcool qui ont déclaré l'un des 5 méfaits liés à leur consommation (incapacité d'arrêter de boire après avoir initié la consommation, incapacité d'effectuer ce qui est normalement attendu de la personne, besoin de boire de l'alcool dès le réveil, incapacité de se souvenir des évènements de la veille, ressentir un sentiment de regret ou de culpabilité en lien avec sa consommation d'alcool).[3]
Par ailleurs, seulement 2% des personnes ayant consommé de l'alcool ou des drogues ont déclaré avoir déjà eu recours à l'aide de professionnels en lien avec leur consommation (médecin, travailleurs sociaux, conseillers, professionnels de la santé). Les hommes seraient d'ailleurs légèrement plus enclins à recourir à une telle aide.[3]
-
Représentation de la consommation d'alcool par personne âgée de plus de 15 ans en litres d'alcool pur annuellement à l'échelle mondiale (2018)
-
Représentation du pourcentage de la population, par pays, aux prises à un TUA (2019)
Étiologies
Le développement d'un TUA est le plus souvent multifactoriel et découle des l'interaction gène-environnement. Il est estimé que jusqu'à 40-60% de la variance du risque pourrait être lié à des facteurs génétiques et héréditaires.[2] Parmi les facteurs qui entretiennent le TUA, on retrouve la modulation neuronale découlant de l'exposition chronique à l'alcool, notamment la modification de l'expression des récepteurs NMDA.[4]
Physiopathologie
De nombreuses hypothèses ont été suggérées pour expliquer la propension de certains patients à développer un TUA. Certaines des théories les mieux étayées incluent la régulation à effet positif, la régulation à effet négatif, la vulnérabilité pharmacologique et la propension à la déviance.
- La régulation à effet positif conduit à boire par recherche d'un sentiment de récompense (tel le sentiment d'euphorie).
- La régulation à effet négatif est observée lorsque l'on boit pour faire face à des sentiments de nature négative (tels la dépression, l'anxiété ou la dévalorisation).
- La vulnérabilité pharmacologique repose sur la variabilité interindividuelle aux effets aigus et chroniques de la consommation d'alcool, ainsi qu'à la capacité à métaboliser l'alcool.
- La prédisposition à la déviance consiste en la tendance d'un individu à adopter un comportement déviant établi pendant l'enfance, souvent en raison d'un déficit de socialisation à un âge précoce.[5]
Sur une base neurobiologique, l'alcool, comme plusieurs substances addictives, produit son effet de renforcement via la libération de dopamine au niveau de l'aire tegmentale ventrale via la voie dopaminergique mésolimbique. Celle-ci est responsable du sentiment de désir et de récompense. Elle possède des projections allant au cortex préfrontal et aux noyeaux accumbens. Ce sont ces projections qui engendrent le désir de consommer à nouveau la substance. Son effet sur les neurones dopaminergiques passe d'abord par la libération d'autres neurotransmetteurs (glutamate, GABA, corticolibérine et sérotonine). Le système cannabinoïde endogène est finalement aussi impliqué dans le développement d'une dépendance à l'alcool.[6]
À plus long terme, l'exposition chronique à l'alcool engendre une modification de la transmission synaptiques de façon durable, voire permanente. Plusieurs facteurs sont impliqués, tels que la modification des récepteurs NMDA et de la transmission glutamatergique, la diminution de la sensibilité des neurones dopaminergiques et l’augmentation de l’activité de la corticolibérine. Globalement, l'effet net de cette neuroplasticité modifie l'équilibre entre l'effet inhibiteur GABA et l'effet excitateur du glutamate, au profit de ce dernier. Il en résulte une hyperactivité neuronale. C'est cet effet hyperexcitable qui déclenche plusieurs symptômes de sevrage, tels l'anxiété et la diminution du seuil convulsif, et qui sont à la base du renforcement négatif entretenant l'usage compulsif chronique de cette substance.[4][6][7]
Ce sont donc ces deux grands principes qui sont adressés par les diverses avenues pharmacologiques employées pour le traitement du TUA :
- la libération dopaminergique liée à la récompense
- l'effet net excitateur lié à l'évitement des effets négatifs.
Présentation clinique
Facteurs de risque
Les principaux facteurs de risque du TUA sont [4][8]:
- les facteurs de risque biologiques :
- l'âge compris entre 18 à 29 ans
- le sexe masculin[note 1]
- l'expression anormale des gènes GABRG2, GABRA2, COMT Val 158Met, DRD2, Taq1A et KIAA0040[5][7][note 2]
- les facteurs de risque psychologiques :
- les troubles de la personnalité sous-jacents, notamment les personnalités limite et anti-sociale
- les troubles de l'humeur, notamment le trouble dépressif caractérisé et la bipolarité
- les troubles anxieux, principalement l'anxiété sociale
- le trouble lié à l'usage d'une substance autre que l'alcool
- l'impulsivité et la recherche de nouveauté.
- les facteurs de risque sociaux :
- le faible niveau socio-économique, particulièrement lorsque tôt dans la vie
- l'acceptation sociale
- les influences culturelles.
Questionnaire
À l'histoire, on retrouvera des épisodes rapportés de consommation excessive d'alcool de plus de quatre ou cinq verres à la fois.
Plusieurs conséquences découlent d'une consommation chronique et abusive d'alcool. Elles prennent différentes formes, soient comportementales, psychiatriques et médicales. En plus des différents critères diagnostiques du DSM V (voir la section Diagnostic), il est possible de rechercher les éléments suivants au questionnaire [2][8]:
- l'histoire détaillée de consommation d'alcool, la présence de co-consommation, ainsi que les antécédents médicaux et psychiatriques
- la présence de symptômes de sevrage en l'absence de consommation
- l'histoire familiale des troubles liés à l'usage de substances
- les traitements tentés antérieurement
- les problèmes judiciaires actuels et passés
- l'absentéisme au travail ou à l'école, la perte d'emploi et les problèmes conjugaux.
Dans un contexte de visite médicale routinière, les patients sont généralement asymptomatiques. Il est tout de même possible que ceux-ci présentent des symptômes liés à leur consommation ou à des complications découlant de celle-ci. Ces symptômes sont les suivants [2][5][8]:
- la dyspepsie, des nausées, des vomissements et de l'hématémèse, pouvant être signes d'un syndrome de Boerhaave ou encore de varices œsophagiennes
- la perte de poids
- les tremblements, les paresthésies, la diminution de l'équilibre, et la diminution de la motricité fine[note 3]
- la dysfonction érectile.
Les symptômes comportementaux et psychiatriques sont également à rechercher et peuvent découler du TUA ou encore être associés à ses comorbidités [2][8]:
- l'altération du sommeil
- l'anxiété
- l'humeur dépressive
- l'atteinte mnésique, incluant l'atteinte de la mémoire au long cours et l'amnésie lors des épisodes d'intoxication
- les difficultés dans les relations interpersonnelles
- les symptômes psychotiques, tels les hallucinations et les idées délirantes
- les idéations suicidaires et les tentatives de suicide antérieures, ainsi que la présence d'un plan.
Examen clinique
L'examen clinique est le plus souvent normal, mais permet parfois d'objectiver les signes suivants, le plus couramment en cas d'atteinte neurologique ou de cirrhose hépatique. Finalement, en contexte de consommation importante et chronique, l'examen de l'apparence générale du patient peut montrer des signes de dénutrition.[8]
- L'examen mental peut être perturbé en contexte d'intoxication aiguë, en présence de comorbidités psychiatriques, ou encore lors de la phase de sevrage :
- l'aggressivité et l'attitude non collaborative
- l'hypersexualité
- l'humeur labile
- l'altération du jugement et la diminution de l'auto-critique.
- L'examen neurologique, étant le plus souvent normal, mais pouvant être perturbé en contexte d'intoxication aiguë :
- la démarche et le discours ébrieux
- l'ataxie (signe clinique)
- la confusion
- l'amnésie
- le nystagmus, pouvant être signe d'une intoxication aiguë ou d'une encéphalopathie de Wernicke
- l'altération de l'état de conscience, pouvant aller jusqu'au coma
- la neuropathie périphérique, lorsqu'en présence d'une consommation au long cours.
- L'examen abdominal et des téguments à la recherche de signes de cirrhose ou d'hypertension portale :
- les signes d'ascite, soient les flancs bombants, le signe du flot et la matité à la percussion déclive
- les signes d'hypertension portale, soient la tête de méduse, l'hépatosplénomégalie et les hémorroïdes
- les angiomes stellaires
- l'érythème palmaire
- la gynécomastie
- l'atrophie testiculaire.
Examens paracliniques
Les examens paracliniques pertinents en présence d'un TUA ne permettent pas de diagnostiquer le TUA, mais plutôt d'en circonscrire les complications et de prescrire le bon traitement pharmacologique[2][5][8].
- la FSC pour rechercher une anémie macrocytaire, une pancytopénie ou une thrombocytopénie (cirrhose ou toxicité directe médullaire à l'alcool)
- une créatininémie (utile avant tout traitement pharmacologique)
- l'hyponatrémie, l'hypokaliémie, hypomagnésémie et hypophosphatémie
- un ratio AST:ALT d'au moins 2:1 suggère une atteinte hépatique secondaire à l'alcool
- une GGT augmentée indique généralement une importante consommation chronique d'alcool (elle peut aussi être utilisée pour suivre l'abstinence puisqu'elle tend à revenir à la normale dans les jours/semaines suivant l'arrêt de la consommation)
- la phosphatase alcaline
- la glycémie à jeûn
- l'augmentation de l'INR et de la bilirubinémie peuvent survenir dans la cirrhose
- une diminution de l'albuminémie permet de dépister un état de dénutrition ou une insuffisance hépatique
- une augmentation de la lipase sérique peut orienter vers une pancréatite chronique alcoolique
- l'éthanolémie est employée en contexte d'intoxication aigüe et d'altération de l'état de conscience, mais sa mesure peut refléter la tolérance du patient à l'alcool
- un bilan lipidique pour l'hypertriglycéridémie et hypercholestérolémie
- la diminution du folate (B9), de la cobalamine (B12) et de la thiamine (B1)
- l'hyperuricémie (ce qui peut provoquer des crises de goutte)
- un β-hCG chez les femmes en âge de procréer (pour la pharmacologie)
- le dépistage des ITSS selon les facteurs de risque.
En contexte de perturbation du bilan hépatique, et surtout en présence de stigmates d'hépatopathie, une échographie abdominale est généralement le premier test d'imagerie à demander.
Diagnostic
Critères diagnostiques du DSM V
Mode d’usage problématique de l’alcool conduisant à une altération du fonctionnement ou une souffrance cliniquement significative, caractérisé par la présence d’au moins deux des manifestations suivantes, au cours d’une période de 12 mois [2].
- L’alcool est souvent consommé en quantité plus importante ou pendant une période plus prolongée que prévu.
- Il y a un désir persistant, ou des efforts infructueux, pour diminuer ou contrôler la consommation d’alcool.
- Beaucoup de temps est passé à des activités nécessaires pour obtenir de l’alcool, à utiliser de l’alcool ou à récupérer de ses effets.
- Envie impérieuse (craving), fort désir ou besoin pressant de consommer de l’alcool.
- Consommation répétée d’alcool conduisant à l’incapacité à remplir des obligations majeures (au travail, à l’école ou à la maison).
- Consommation continue d’alcool malgré des problèmes interpersonnels ou sociaux, persistants ou récurrents, causés ou exacerbés par les effets de l’alcool.
- Des activités sociales, professionnelles ou de loisirs importantes sont abandonnées ou réduites à cause de l’usage de l’alcool.
- Consommation répétée d’alcool dans des situations où cela peut être physiquement dangereux.
- L’usage de l’alcool est poursuivi bien que la personne sache avoir un problème psychologique ou physique persistant ou récurrent susceptible d’avoir été causé ou exacerbé par l’alcool.
- Tolérance, définie par l’un des symptômes suivants :
- Besoin de quantités notablement plus fortes d’alcool pour obtenir une intoxication ou l’effet désiré;
- Effet notablement diminué en cas de l’usage continu de la même quantité d’alcool.
- Sevrage caractérisé par l’une ou l’autre des manifestations suivantes :
- Syndrome de sevrage caractéristique de l’alcool;
- L’alcool (ou une substance très proche, telle qu’une benzodiazépine) est pris pour soulager ou éviter les symptômes de sevrage.
Spécifications
- En rémission précoce : Après que tous les critères du trouble de l’usage de l’alcool aient été préalablement remplis, plus aucun ne l’a été pendant au moins 3 mois mais pendant moins de 12 mois (à l’exception du critère 4, « Envie impérieuse [craving], fort désir ou besoin pressant de consommer de l’alcool », qui peut être rempli).
- En rémission prolongée : Après que tous les critères du trouble de l’usage de l’alcool aient été préalablement remplis, plus aucun ne l’a été à aucun moment pendant au moins 12 mois (à l’exception du critère 4, « Envie impérieuse [craving], fort désir ou besoin pressant de consommer de l’alcool », qui peut être rempli).
- En environnement protégé : Cette spécification supplémentaire est utilisée si le sujet est dans un environnement où l’accès à l’alcool est limité.
- Sévérité
- Léger : Présence de 2-3 symptômes
- Moyen : Présence de 4-5 symptômes
- Grave : Présence de 6 symptômes ou plus
Outils cliniques
Plusieurs outils cliniques existent et peuvent aider le clinicien à évaluer objectivement le risque que son patient soit atteint d'un TUA. En voici quelques-uns :
- Questionnaire CAGE[9] : Un score de 2 ou plus au questionnaire CAGE est suggestif d'un TUS sous-jacent. Ce test est facile et rapide à administrer en clinique.
- Questionnaire AUDIT-10 : un questionnaire de dépistage, et sa version abrégée de 3 questions (AUDIT-C)
- 10 questions avec réponses comprises entre 0 et 4 points
- Un score < 8 est peu suggestif d'un TUA.
- Un score compris entre 8 et 15, requiert d'aborder les recommandations sur la consommation sécuritaire de l'alcool.
- Un score compris entre 16 et 19 nécessite un counseling et d'explorer la consommation d'alcool lors de visites subséquentes.
- Un score > 20 est fortement suggestif d'un TUA et nécessite une prise en charge appropriée selon le stade de changement du patient.
- 10 questions avec réponses comprises entre 0 et 4 points
Diagnostic différentiel
Le diagnostic différentiel est le suivant [2][5]:
- la consommation non pathologique d'alcool
- le trouble de l'usage des sédatifs, le trouble de l'usage des hypnotiques et le trouble de l'usage des anxiolytiques
- les formes d'auto-médication, notamment en contexte de troubles anxieux ou de troubles thymiques
- les troubles anxieux
- les troubles de l'humeur.
Traitement
Dans une visée de continuum des soins et selon une approche de réduction des méfaits, la décision de traiter un TUA repose sur une décision partagée avec le patient et comprendra la planification du sevrage de la substance ainsi que la prévention des rechutes. La prise en charge par une équipe multidisciplinaire permettra finalement de favoriser les chances de succès de l'abandon de la substance. Au final, un patient dont l'auto-critique face à son TUA est faible, ou qui n'est pas ouvert au changement, sera peu investi dans sa thérapie. Une approche de réduction des méfaits est donc souvent à favoriser, avec un suivi médical et psycho-social approprié.
La section qui suit est en grande partie basées sur le Guide d'usage optimal - Sevrage d'alcool et prévention des rechutes[10] publié par l'INESSS en août 2021. Ces recommandations s'appliquent pour les individus âgés de plus de 18 ans, et excluent les femmes enceintes ou qui allaitent.
Traitement non pharmacologique
Bien que les traitements pharmacologiques devraient être offerts à tous les patients, l'approche non pharmacologique demeure essentielle. Elle n'est par ailleurs pas coercitive et ne devrait pas limiter l'accès aux agents pharmacologiques. Les traitements à suggérer sont [5][10][11]:
- renseigner les patients sur les méfaits de l'alcool
- suggérer le retrait de tout alcool du logis
- soutenir la motivation à atteindre les objectifs en lien avec le TUA
- offrir un soutien psychosocial
- envisager les approches psychoéducative et de thérapie cognitivo-comportementale (TCC)
- recommander les groupes de soutien, tels les Alcooliques Anonymes (AA), et encourager les membres de la famille à assister à certaines rencontres
- orienter le patient à un centre de thérapie fermée
- impliquer les organismes communautaires locaux, qui peuvent offrir de nombreux services, tout en participant à briser l'isolement
- recourir au Centre de réadaptation en dépendances des régions spécifiques, ou leur équivalent.
Traitement pharmacologique d'aide au maintien de l'abstinence
Tout patient atteint d'un TUA et voulant cesser sa consommation d'alcool devrait se voir offrir une aide pharmacologique au maintien de l'abstinence en raison du haut taux d'échec en l'absence de pharmacothérapie. L'approche sera individualisée selon les objectifs de traitement (ex. l'abstinence, la réduction de la consommation), et le choix des modalités reposera notamment sur la présence de comorbidités (ex. trouble anxieux, troubles du sommeil).[10][12][13]
Les médicaments sélectionnés devraient être servis à la pharmacie de façon fractionnée afin de limiter le potentiel d'abus (notamment pour le gabapentin et le topiramate). Au besoin, le recours au programme Alerte (pour le Québec) peut être envisagé. La fréquence des services sera ajustée selon l'alliance thérapeutique avec le patient et son observance.
Les contre-indications au traitement pharmacologique sont :
- être âgé de moins de 18 ans
- être enceinte ou allaiter
- présenter des signes ou de symptômes de sevrage.
Il peut être acceptable de débuter un traitement d'aide au maintien de l'abstinence en fin de sevrage, mais cette approche n'est pas recommandée puisqu'elle ne permet pas de distinguer les symptômes du sevrage des effets secondaires de la médication.[10]
La naltrexone[RA: 1,36[14]] est la molécule de premier choix, où le rapport de cotes représente l'efficacité quant au maintien de l'abstinence comparativement au placebo. Elle est la molécule recommandée actuellement en raison de divers facteurs, notamment la possibilité de débuter celle-ci alors que le patient consomme encore, la réduction de l'état de manque (craving), la prise DIE, ainsi que la couverture de cette molécule par le régime public québécois. Malgré un RA légèrement inférieure à celui de l'acamprosate pour le maintien de l'abstinence, est est également démontrée efficace pour : (1) la diminution des jours de forte consommation, soit plus de 4 pour la femme et 5 pour l'homme, et (2) l'abstinence cumulative, soit le nombre de jours totaux non consécutifs sur une période donnée. Cette molécule peut ainsi être utilisée dans le contexte du maintien de l'abstinence, mais également dans un but de diminution de la consommation[15][16][17].
L'acamprosate[NNT: 4,6][RC: 1,86[18]] est pour sa part recommandée pour le maintien strict de l'abstinence et semble par ailleurs légèrement plus efficace à cette fin que la naltrexone.
| naltrexone[RC: 1,36[19]]
(1ere intention)[note 4] |
gabapentine
(2e intention)[note 5] |
acamprosate[NNT: 4,6][RC: 1,86[20]]
(2e intention)[note 6] |
topiramate[RC: 1,88[21]]
(2e intention)[note 7] | |
|---|---|---|---|---|
| Dosage |
|
|
|
|
| Interactions
médicamenteuses |
|
|
|
|
| Effets secondaires |
|
|
|
|
| Contre-indications |
|
|
|
|
| Suivi |
| |||
|
|
|
| |
Certaines autres molécules ont démontré leur efficacité, notamment la quétiapine. Il est toutefois à savoir que les évidences sont plus hétérogènes concernant l'efficacité de cette molécule.[17]
L'usage du disulfiram est par ailleurs déconseillée, notamment dans le contexte où son efficacité a été uniquement démontrée en contexte supervisé, qu'elle doit être débutée après l'atteinte de l'abstinence et que la consommation d'alcool concomitante à la prise de ce médicament peut représenter des dangers pour la santé.[16]
Suivi
Le suivi peut être effectué par tous les membres de l'équipe multidisciplinaire s'occupant du patient.
On peut généralement s'attendre à une amélioration après 3 mois de traitement avec l'acamprosate et 6 mois avec les autres molécules. L'absence des critères du TUA pendant une période de 3 à 12 mois est considéré comme une rémission précoce, tandis l'absence de ces mêmes critères pendant une période de plus de 12 mois est considéré comme une rémission du TUA.
En cas d'échec au maintien de l'abstinence, ou en cas de ré-augmentation des quantités d'alcool consommées si la réduction de la consommation était l'objectif, il est possible de tenter une intensification du suivi en ambulatoire, ou encore de référer le patient vers un milieu spécialisé d'accompagnement des patients aux prises à une dépendance.[10][13]
Complications
Le trouble lié à l'usage de l'alcool entraîne de nombreuses conséquences sur la santé et le contexte de vie du patient, mais aussi de son entourage. Ce sont jusqu'à 40% des personnes aux troubles avec un TUA qui en subiront les conséquences. D'après les rapports de l'OMS, il est associé à au moins 3 millions de décès chaque année, la plupart d'entre eux survenant chez les hommes. Outre la mort, les troubles liés à la consommation d'alcool sont associés à [5]:
- les traumatismes non intentionnels, incluant les accidents de la route
- la cirrhose
- l'encéphalopathie de Wernicke et le syndrome de Korsakoff
- les cancers oropharyngés
- le carcinome hépatocellulaire
- le cancer du sein
- le cancer de la vessie
- l'accident vasculaire cérébral hémorragique
- l'augmentation du taux de criminalité, incluant les homicides
- le suicide.
Évolution
La sévérité de la consommation d'alcool ne semble pas avoir de franche corrélation avec le cours naturel de la maladie. Selon une étude longitudinale faites chez des consommateurs hommes, la sévérité de la consommation initiale d'alcool n'était pas associée à l'évolution clinique du patient 4 ans plus tard.[8]
Prévention
Bien qu'il n'existe pas de lignes directrices claires à ce sujet, il est recommandé de dépister périodiquement la consommation d'alcool chez les patients d'offrir un support psycho-social et de référer ces patients vers les ressources appropriées permettant de prendre en charge la cessation tabagique si le clinicien n'est pas en mesure de le faire lui-même.[22]
De façon similaire, le dépistage universel des complications chez les patients atteints d'un TUA n'est pas clairement défini, mais il peut être justifié de dépister l'atteinte hépatique dans le cadre d'un bilan de dépistage au moyen de la mesure de l'ALT. En cas de perturbation de celle-ci, plusieurs cliniciens complètent ensuite un bilan hépatique plus élargis et envisagent une imagerie abdominale selon les trouvailles. Cette approche, en s'assurant d'informer le patient avant d'inclure la mesure de l'ALT au bilan, peut ensuite être utilisé comme un levier de changement auprès des patients.[23][24]
Notes
- ↑ Le trouble de l'usage de l'alcool est plus rarement cliniquement manifeste chez la femme. Les femmes sont plus susceptibles aux effets physiologiques néfastes de l'alcool, tels que la neurotoxicité et le développement d'une cirrhose.
- ↑ Ces gênes peuvent influencer le métabolisme de l'alcool, l'effet de la substance sur le système nerveux central, les traits de personnalité sous-jacents et la comorbidité avec d'autres troubles psychiatriques.
- ↑ Pouvant être liés à une atteinte cérébelleuse ou une atteinte nerveuse périphérique.
- ↑ Mécanisme d'action : agoniste non sélectif des récepteurs opioïdes δ, κ et μ. Diminue l'activité opioïdergique dans la région mésolimbique, ce qui module l'effet de récompense médié par la dopamine associé à la prise d'alcool.
- ↑ Mécanisme d'action : Analogue GABA. Mécanisme peu compris.
- ↑ Module la neurotransmission glutamatergique.
- ↑ Mécanisme inconnu. Pourrait augmenter l'activité inhibitrice GABAergique et inhiber les canaux sodiques voltage- dépendant au niveau du cerveau.
- ↑ ex. ↑ tous les 3 jours sur +/- 5 paliers
- ↑ Ex. par paliers de 25 mg par semaine
Références
- Cette page a été modifiée ou créée le 2021/11/05 à partir de Alcohol Use Disorder (StatPearls / Alcohol Use Disorder (2021/04/16)), écrite par les contributeurs de StatPearls et partagée sous la licence CC-BY 4.0 international (jusqu'au 2022-12-08). Le contenu original est disponible à https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28613774 (livre).
- ↑ Pierre Patigny, Nicolas Zdanowicz et Brice Lepiece, « How should psychiatrists and general physician communicate to increase patients' perception of continuity of care after their hospitalization for alcohol withdrawal? », Psychiatria Danubina, vol. 30, no Suppl 7, , p. 409–411 (ISSN 0353-5053, PMID 30439814, lire en ligne)
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 et 2,7 American Psychiatric Association, DSM-5 - Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, États-Unis, Elsevier Health Sciences France, , p. 632-658
- ↑ 3,0 3,1 et 3,2 « Enquête canadienne sur l’alcool et les drogues (ECAD) : sommaire des résultats pour 2019 », sur Gouvernement du Canada, (consulté le 20 décembre 2021)
- ↑ 4,0 4,1 et 4,2 Pierre Lalonde, Psychiatrie Clinique, Montréal, Chenelière éducation, , 1081 p., p. 849-872
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 et 5,6 Sara M. Nehring et Andrew M. Freeman, StatPearls, StatPearls Publishing, (PMID 28613774, lire en ligne)
- ↑ 6,0 et 6,1 Robin C. Wackernah, Matthew J. Minnick et Peter Clapp, « Alcohol use disorder: pathophysiology, effects, and pharmacologic options for treatment », Substance Abuse and Rehabilitation, vol. 5, , p. 1–12 (ISSN 1179-8467, PMID 24648792, Central PMCID 3931699, DOI 10.2147/SAR.S37907, lire en ligne)
- ↑ 7,0 et 7,1 Francisco J. Pavón, Antonia Serrano, David G. Stouffer et Ilham Polis, « Ethanol-induced alterations in endocannabinoids and relevant neurotransmitters in the nucleus accumbens of fatty acid amide hydrolase knockout mice », Addiction Biology, vol. 24, no 6, , p. 1204–1215 (ISSN 1369-1600, PMID 30421483, Central PMCID 6551299, DOI 10.1111/adb.12695, lire en ligne)
- ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 et 8,6 « UpToDate », sur www.uptodate.com (consulté le 21 novembre 2021)
- ↑ J. A. Ewing, « Detecting alcoholism. The CAGE questionnaire », JAMA: The Journal of the American Medical Association, vol. 252, no 14, , p. 1905–1907 (DOI 10.1001/jama.252.14.1905, lire en ligne)
- ↑ 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 et 10,5 Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Sevrage d’alcool et prévention des rechutes – Guide d’usage optimal. Rédigé par Caroline Poisson et Catherine Awad. Québec, Qc : INESSS; 2021. 12 p. (ISBN 9782550898597, lire en ligne)
- ↑ Lode Godderis, Emma Boonen, Ana L. Cabrera Martimbianco et Ellen Delvaux, « WHO/ILO work-related burden of disease and injury: Protocol for systematic reviews of exposure to long working hours and of the effect of exposure to long working hours on alcohol consumption and alcohol use disorders », Environment International, vol. 120, , p. 22–33 (ISSN 1873-6750, PMID 30055358, DOI 10.1016/j.envint.2018.07.025, lire en ligne)
- ↑ (en) Henry R. Kranzler, « Diagnosis and Pharmacotherapy of Alcohol Use Disorder, A Review », Journal of the American Medical Association (JAMA), , p. 815-825 ([doi:10.1001/jama.2018.11406 lire en ligne])
- ↑ 13,0 et 13,1 « Initier un traitement pharmacologique pour la prévention des rechutes chez une personne avec un trouble lié à l’usage d’alcool », sur Iness.qc.ca (consulté le 12 novembre 2021)
- ↑ 10.1136/bmj.m3934
- ↑ Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Sevrage d’alcool et prévention des rechutes – Rapport en soutien au guide d’usage optimal. Rédigé par Caroline Poisson et Catherine Awad. Québec, Qc : INESSS; 2021. 259 p.
- ↑ 16,0 et 16,1 « Les interventions pour le maintien de l’abstinence de l’alcool en externe », sur TopMF (consulté le 25 février 2022)
- ↑ 17,0 et 17,1 Hung-Yuan Cheng, Luke A. McGuinness, Roy G. Elbers et Georgina J. MacArthur, « Treatment interventions to maintain abstinence from alcohol in primary care: systematic review and network meta-analysis », BMJ (Clinical research ed.), vol. 371, , m3934 (ISSN 1756-1833, PMID 33239318, Central PMCID 7687021, DOI 10.1136/bmj.m3934, lire en ligne)
- ↑ 10.1136/bmj.m3934
- ↑ 10.1136/bmj.m3934
- ↑ 10.1136/bmj.m3934
- ↑ 10.1136/bmj.m3934
- ↑ « Fiche de prévention clinique », sur Collège des médecins du Québec, (consulté le 12 février 2021)
- ↑ Opinion d'expert (N/A) [2022-01-07] Conduite ayant été fréquemment mentionnée dans le cadre de la discussion de médecins de première ligne sur un forum en ligne.
- ↑ « Screening for unhealthy use of alcohol and other drugs in primary care », sur UpToDate (consulté le 12 février 2022)