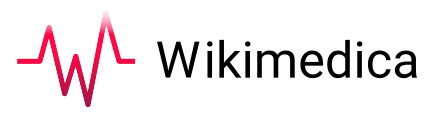Asystolie
| Maladie | |||
 Asystolie à l'ECG | |||
| Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|
| Signes | Apnée, Absence de pouls palpable, Absence de bruit cardiaque, Inconscient, Respiration agonique | ||
| Symptômes |
| ||
| Diagnostic différentiel |
Fibrillation ventriculaire fine | ||
| Informations | |||
| Terme anglais | Asystole | ||
| Autres noms | Flatline | ||
| Wikidata ID | Q752800 | ||
| SNOMED CT ID | 397829000 | ||
| Spécialités | Cardiologie, Médecine d'urgence, Soins intensifs, Anesthésie, Médecine interne | ||
| |||
L'asystolie est définie par la cessation de l'activité électrique et mécanique du coeur[1].
Épidémiologie
Chaque année, environ 300 000 à 400 000 Américains subissent un arrêt cardiaque extrahospitalier dont le taux de mortalité est extrêmement élevé. Pour ces cas, les chances de survie oscillent alors de 4,6 % à 11 %. Les données varient selon les régions du pays et les études[2][3][4].
Étiologies
Les causes d'asystolie sont nombreuses et variées. En général, l'asystolie est le résultat de la décompensation de la fibrillation ventriculaire prolongée ou de la détérioration des rythmes ventriculaires initiaux non perfusants (FV ou TVSP). La prolongation d'une activité électrique sans pouls (PEA) peut conduire à l'asystolie, et une tentative de défibrillation d'une tachycardie ventriculaire ou d'une fibrillation ventriculaire peut précipiter une asystolie. Toute cause d'arrêt cardiaque peut également entraîner une asystolie si elle n'est pas traitée rapidement. Les causes réversibles de l'arrêt cardiaque doivent être prises en compte[1][5][6].
Les causes d'arrêt cardiaque réversibles peuvent être résumées par les 6Hs et 6Ts,
| Hs | Ts |
|---|---|
| hypovolémie | pneumothorax sous tension |
| hypoxie | tamponnade cardiaque |
| Ion hydrogène (acidose) | Toxines |
| hypokaliémie/hyperkaliémie | Thrombose pulmonaire |
| hypoglycémie | Thrombose coronarienne |
| hypothermie | traumatisme |
Physiopathologie
L’asystolie résulte d’une défaillance du système électrique intrinsèque du cœur ou d’une cause extracardiaque[1].
Présentation clinique
Questionnaire
Le questionnaire est impossible pour les patients en asystolie puisque ces derniers sont inconscients. Toutefois, les patients peuvent présenter des symptômes en lien avec l'étiologie de l'asystolie avant de perdre conscience.
Il est fréquent qu'avant de perdre conscience les patients présentent :
- des douleurs thoraciques
- de la dyspnée
- une condition hypoxémiante sous-jacente.
Il est nécessaire de rechercher la présence des éléments suivants au dossier :
- le patient se présente dans un contexte de trauma ou de chute importante
- des antécédents de thromboses veineuses récentes ou anciennes
- des antécédents de MCAS
- des antécédents de diabète
- des antécédents d'insuffisance rénale chronique
- documenter la dernière créatinine et les électrolytes au dossier
Lors d'un cas d'asystolie, il est important d'avoir accès à l'ensemble du dossier du patient au chevet pour faciliter la communication avec le reste de l'équipe.
Examen clinique
À l'examen, on pourra noter [1] :
- à l'examen cardiaque : une absence de pouls palpable, une absence de bruit cardiaque
- à l'examen pulmonaire : une respiration agonique, une apnée
- à l'évaluation de l'état de conscience : le patient est inconscient.
Examens paracliniques
Les examens paracliniques comprennent [1] :
- une FSC : une anémie sévère pourrait avoir provoqué l'arrêt cardiaque
- la kaliémie : une hypo/hyperkaliémie pourrait avoir provoqué l'arrêt cardiaque
- une glycémie : une hypoglycémie pourrait avoir provoqué l'arrêt cardiaque
- un gaz artériel/capillaire/veineux : une acidose métabolique
- à l'électrocardiogramme ou au monitorage cardiaque : une ligne isoélectrique, une absence d'onde P, une absence de QRS, une absence d'onde T
- une échographie cardiaque transthoracique peut être effectuée pour documenter :
- une absence de mouvement cardiaque
- une dilatation du ventricule droit (embolie pulmonaire)
- un épanchement péricardique
- une échographie pulmonaire :
- présence d'un pneumothorax.
Diagnostic
Le diagnostic est posé par la présence d'une onde isoélectrique plate à l'électrocardiogramme ou au monitorage cardiaque.
Diagnostic différentiel
Le diagnostic différentiel comprend les situations suivantes :
- la fibrillation ventriculaire fine
- un câble de moniteur débranché
- un fil de moniteur mal collé sur le patient
- un moniteur éteint.
Traitement
L'asystolie doit être traitée conformément aux directives actuelles du Basic Life Support et de l'ACLS de l'American Heart Association.
Identification d'un arrêt cardiaque
Extrahospitalier
Le secouriste doit vérifier si le patient respire normalement. L'accent est mis sur le «halètement» ou la respiration agonique anormale. Si le patient ne respire pas ou n'a que des respirations agoniques, le secouriste doit rechercher un pouls carotidien pour l'adulte qui ne répond pas ou un pouls brachial pour le nourrisson qui ne répond pas, et ce pendant 10 secondes tout au plus. Si un pouls n'est pas ressenti ou si le secouriste ne peut dire si un pouls a été ressenti, la réanimation cardiorespiratoire (RCR (1ere intention)) doit être initiée immédiatement.
Intrahospitalier
Le personnel soignant doit s'assurer que, si un patient semble être en asystolie sur le moniteur cardiaque, il est en fait en arrêt cardiaque. Les moniteurs cardiaques déconnectés ou mal installés sont susceptibles de faire croire à une asystolie. De plus, le personnel soignant doit faire la différence entre l'asystolie et la fibrillation ventriculaire fine, résultats possibles à la défibrillation.
Réanimation
La marche à suivre pour la réanimation inclut :
- La RCR qui est le pilier du traitement. Elle doit être faite avec interruption minimale (moins de cinq secondes). Il ne faut pas interrompre la RCR dans l'idée de procéder à l'intubation endotrachéale.
- L'asystolie est un rythme non choquable [note 1]. Par conséquent, si une asystolie est notée sur le moniteur cardiaque, la défibrillation ne doit pas être tentée.
Médical
Les traitements médicaux sont [1] :
- épinéphrine 1 mg IV/IO q 3-5 min
- le traitement de la cause sous-jacente, si elle est réversible (6H 6T)
- hypothermie thérapeutique : certains experts recommandent d'induire une hypothermie chez tous les patients qui survivent à un arrêt cardiaque afin d'améliorer leur pronostic cérébral
- vasopressine
- peut être administrée avant ou après l'épinéphrine, mais les bénéfices demeurent discutables
- stimulation transcutanée
- même si elle est largement pratiquée, il n'y a aucune preuve qu'elle améliore la survie
- admission aux soins intensifs.
Arrêt des traitements
Extrahospitalier
Lors d'un arrêt cardiaque hors de l'hôpital, il est peu probable que des efforts de réanimation prolongés chez un patient présentant une asystolie apportent un bénéfice clinique. L'arrêt des efforts de réanimation doit être envisagé chez ces patients, comme le permettent les protocoles locaux. L'American College of Emergency Physicians et l'Association nationale des médecins des services médicaux d'urgence (NAEMSP) ont des protocoles officiels qui permettent de mettre fin aux efforts de réanimation par les prestataires de services médicaux d'urgence pour un groupe sélectionné de patients. Ces protocoles considèreraient également les autres mesures de réanimation ainsi que le transport vers le service d'urgence local comme futiles[1][7].
Intrahospitalier
L'asystolie est considérée comme un rythme terminal d'arrêt cardiaque. Par conséquent, une discussion sur l'arrêt de la réanimation doit être envisagée lors d'un arrêt cardiaque à l'hôpital selon le tableau clinique. L'arrêt des manœuvres de réanimation chez les patients en arrêt cardiaque extrahospitalier sur une asystolie doit également être envisagé conformément au protocole local[1][7].
Lorsqu'on envisage de mettre fin aux soins d'un patient en asystolie, le rythme doit être confirmé au monitorage dans deux dérivations distinctes[1].
Complications
La seule complication est le décès.
Évolution
Le pronostic de l'asystolie dépend de la cause du rythme, du moment de l'intervention et du succès de l'ACLS. Les victimes d'arrêt cardiaque soudain qui présentent une asystolie comme rythme initial ont un pronostic très défavorable (10% survivent à l'admission; 0% à 2% reçoivent le congé de l'hôpital)[2][3][8]. Globalement, le pronostic est peu favorable et la survie est encore plus précaire en cas de présence d'asystolie à la suite d'une réanimation. Des études récentes révèlent de meilleurs résultats, mais de nombreux patients affectés par l'asystolie conservent des déficits neurologiques résiduels qui les empêchent de fonctionner de manière autonome[1].
Prévention
La prévention de l'asystolie passe par la prévention des étiologies pouvant la provoquer.
Notes
Références
- Cette page a été modifiée ou créée le 2020/11/07 à partir de Asystole (StatPearls / Asystole (2020/08/10)), écrite par les contributeurs de StatPearls et partagée sous la licence CC-BY 4.0 international (jusqu'au 2022-12-08). Le contenu original est disponible à https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28613616 (livre).
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 et 1,9 Matthew R. Jordan, Richard A. Lopez et Daphne Morrisonponce, StatPearls, StatPearls Publishing, (PMID 28613616, lire en ligne)
- ↑ 2,0 et 2,1 Ian R. Drennan, Steve Lin, Daniel E. Sidalak et Laurie J. Morrison, « Survival rates in out-of-hospital cardiac arrest patients transported without prehospital return of spontaneous circulation: an observational cohort study », Resuscitation, vol. 85, no 11, , p. 1488–1493 (ISSN 1873-1570, PMID 25128746, DOI 10.1016/j.resuscitation.2014.07.011, lire en ligne)
- ↑ 3,0 et 3,1 Laurie J. Morrison, Don Eby, Precilla V. Veigas et Cathy Zhan, « Implementation trial of the basic life support termination of resuscitation rule: reducing the transport of futile out-of-hospital cardiac arrests », Resuscitation, vol. 85, no 4, , p. 486–491 (ISSN 1873-1570, PMID 24361458, DOI 10.1016/j.resuscitation.2013.12.013, lire en ligne)
- ↑ Joshua C. Reynolds, Adam Frisch, Jon C. Rittenberger et Clifton W. Callaway, « Duration of resuscitation efforts and functional outcome after out-of-hospital cardiac arrest: when should we change to novel therapies? », Circulation, vol. 128, no 23, , p. 2488–2494 (ISSN 1524-4539, PMID 24243885, Central PMCID 4004337, DOI 10.1161/CIRCULATIONAHA.113.002408, lire en ligne)
- ↑ Monica E. Kleinman, Zachary D. Goldberger, Thomas Rea et Robert A. Swor, « 2017 American Heart Association Focused Update on Adult Basic Life Support and Cardiopulmonary Resuscitation Quality: An Update to the American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care », Circulation, vol. 137, no 1, 01 02, 2018, e7–e13 (ISSN 1524-4539, PMID 29114008, DOI 10.1161/CIR.0000000000000539, lire en ligne)
- ↑ Ashish R. Panchal, Katherine M. Berg, Peter J. Kudenchuk et Marina Del Rios, « 2018 American Heart Association Focused Update on Advanced Cardiovascular Life Support Use of Antiarrhythmic Drugs During and Immediately After Cardiac Arrest: An Update to the American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care », Circulation, vol. 138, no 23, 12 04, 2018, e740–e749 (ISSN 1524-4539, PMID 30571262, Central PMCID 7324904, DOI 10.1161/CIR.0000000000000613, lire en ligne)
- ↑ 7,0 et 7,1 Michael G. Millin, Samiur R. Khandker et Alisa Malki, « Termination of resuscitation of nontraumatic cardiopulmonary arrest: resource document for the National Association of EMS Physicians position statement », Prehospital emergency care: official journal of the National Association of EMS Physicians and the National Association of State EMS Directors, vol. 15, no 4, , p. 547–554 (ISSN 1545-0066, PMID 21843074, DOI 10.3109/10903127.2011.608872, lire en ligne)
- ↑ Paul S. Chan, Renuka Jain, Brahmajee K. Nallmothu et Robert A. Berg, « Rapid Response Teams: A Systematic Review and Meta-analysis », Archives of Internal Medicine, vol. 170, no 1, , p. 18–26 (ISSN 1538-3679, PMID 20065195, DOI 10.1001/archinternmed.2009.424, lire en ligne)