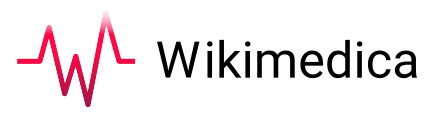Santé et facteurs déterminants
| Concept | |
| Informations | |
|---|---|
| Terme anglais | Social determinants of health |
| Autres noms | Facteurs déterminants de la santé |
| Spécialité | Santé publique |
|
| |
Concepts de la santé et ses facteurs déterminants (78-1)
Les concepts entourant la santé et ses facteurs déterminants sont clés dans l'approche d'un patient dans sa globalité. Bien souvent, les facteurs déterminants ont un effet plus important sur la santé générale des populations que les maladies qui la touchent. Parmi ces facteurs, l'on compte:
- le niveau de revenu et le statut social;
- le réseau social;
- l'éducation et l'alphabétisme;
- l'emploi et les conditions de travail;
- les milieux social et professionnel;
- les environnements physiques.[1]
Concepts
| Concepts | Définitions |
|---|---|
| Bien-être | État dynamique à la fois physique, mental, social et spirituel qui permet à une personne d'atteindre son plein potentiel et de mener une vie heureuse |
| Santé | (diverses définitions) Les plus connues = OMS
|
| Maladie | Expérience ou perception subjective par un individu de manque de bien-être physique ou mental et l'incapacité de remplir normalement son rôle social qui en découle. |
| Handicap | Désavantage d'un individu résultant d'une incapacité et l'empêchant de remplir normalement son rôle ou qui affecte ses relations avec les autres ou son environnement. |
| Incapacité | Restriction ou manque de capacité d'un humain d'accomplir une activité selon les normes prévues. |
Facteurs déterminants de la santé
| Déterminants | Définitions |
|---|---|
| Revenu et statut social (socioéconomique) | Plus une personne a un revenu élevé, meilleur est son état de santé. Plus l’individu occupe une position sociale élevée, meilleur est son pronostic de santé. Cela s’explique en grande partie par le lien avec le sentiment de contrôle sur sa vie et le niveau de stress plus bas. La richesse est inégalement distribuée et contribue à accroître les écarts de santé. |
| Réseau de support social | L’accès a un réseau de support et d’entraide (familial, amical, autre) réduit le risque de mortalité précoce. Les individus isolés, sans travail par exemple, sont à risque. |
| Éducation et alphabétisation | Les individus éduqués ont un meilleur sentiment de contrôle sur leur vie, ont accès a de meilleurs revenus, à un environnement plus sain et ont tendance à adopter de meilleures habitudes de vie. Le système d’éducation public contribue a réduire les inégalités en éducation, mais des inégalités demeures (universitaires versus diplôme professionnel) |
| Emploi et condition de travail | Le chômage accroit la précarité financière, diminue le réseau social et augmente le niveau de stress des individus. Les conditions de travail peuvent avoir un impact majeur sur la santé (ex : effort physique, exigences très élevées, exposition à des toxines) Des populations immigrantes, autochtones, rurales ou sans abris ont des taux de chômage plus élevé qui affecte leur niveau de santé. |
| Environnement social | Le soutien de la communauté, les conditions sociales (solidarité vs violence, racisme) sont des facteurs qui permettent de réduire certains dangers menaçant la santé.
Les politiques gouvernementales contribuent à l’environnement social. |
| Environnement physique et bâti | L’air, l’eau, le sol et les aliments peuvent être les vecteurs de maladie comme la MPOC, la dysenterie, les cancers (radon), etc. L’accès à des infrastructures sportives peut inciter à de meilleures habitudes de vie. Un environnement physique de meilleure qualité accroit le niveau de santé. |
| Capacité d'adaptation et habitudes de vie | Une bonne capacité d’adaptation permet de surmonter les défis et de faire des choix relatifs à sa santé en évitant les comportements à risque (ex : alcool, drogues) Le tabac, la malnutrition et la sédentarité sont des habitudes de vie néfastes dont les risques pour la santé humaine ont été abondamment démontrés. |
| Développement pédiatrique sain | La stimulation et les expériences de l’enfant jusqu’à l’âge de 6 ans sont celles qui contribuent le plus à son développement cognitif. La négligence ou de mauvaises expériences peuvent réduire sa capacité d’apprentissage, son estime de soi, ses habiletés relationnelles et sa capacité de faire des choix positifs pour sa santé. |
| Hérédité | Le patrimoine génétique influe grandement sur la santé des individus (maladies héréditaires, prédispositions, épigénétique, etc.) |
| Services de santé / système de santé | L’accessibilité a des services de santé permet d’améliorer la santé d’une population (ex : vaccination, dépistage, traitement, prévention, etc.) |
| Genre | Les hommes ont une espérance de vie inférieure aux femmes.
Les femmes sont plus à risque de dépression et de certaines maladies chroniques. |
| Culture | Les Autochtones sont généralement plus à risque de maladies chroniques.
Les Inuits ont un taux de suicide très élevé en comparaison de la moyenne canadienne. Les immigrants et réfugiés ont tendance à avoir de meilleurs résultats académiques que les non-immigrants. Les choix personnels, alimentaires, sociaux et autre sont affectés par la culture et les croyances. Certaines communautés peuvent vivre de la stigmatisation, de la marginalisation vis-à-vis la culture dominante et réduire, par exemple, l’accessibilité des soins. |
Actions de santé publique et évolution de la maladie
Les actions de santé publique et de santé clinique tiennent compte de l'évolution des maladies que l'on souhaite traiter.[2]
Ainsi, la santé publique cherchera à modifier les déterminants sociaux reliés aux problématiques avant qu’elles n’apparaissent (prévention primaire). Il s’agit d’un travail de longue haleine qui exige beaucoup de données, de consultations, etc. Ces déterminants amènent des facteurs de risque qui contribuent à la genèse de la maladie. Le clinicien peut également agir à ce niveau, par exemple en incitant un patient à risque à modifier ses habitudes de vie avant l’apparition de la maladie.[2]
Lors de la phase préclinique d’une maladie, celle-ci n’a pas de symptômes, et les patients ne consultent pas. C’est le stade où visent à agir les programmes de dépistage. (ex : PQDCS). En effet, on élabore des tests qui permettent de détecter la présence d’une maladie avant qu’elle ne se manifeste afin de la traiter. Évidemment, l’objectif est de modifier le cours de la maladie et le pronostic. Si l’intervention n’a aucun effet sur le cours des choses, il est inutile de dépister.[2]
La phase clinique est le stade où la maladie est diagnostiquée et traitée avec l’arsenal thérapeutique disponible. Cela inclue les soins du système de santé public ou le contrôle et le traitement des épidémies infectieuses par exemple.[2]
La phase postclinique est le moment pour la prévention tertiaire, faite par les cliniciens. C’est-à-dire prendre des actions qui vont prévenir les rechutes et/ou l’aggravation de la maladie (ex : récidive d’AVC)[2]
Culture, spiritualité et santé
Le clinicien doit tenir compte de la culture et les croyances du patient dans sa prise en charge et la façon d’aborder une problématique. Par exemple, dans certaines cultures, la maladie correspond à l’incapacité de remplir son rôle social. Dans ce cas, il sera très difficile d’expliquer et convaincre un patient de traiter une maladie qui ne le limite pas (HTA, DB).[2]
Un patient très religieux et croyant à la vie après la mort ou ayant des rites particuliers n’envisagera pas le traitement de la même manière (transfusions sanguines (témoins de Jéhovah), soins palliatifs vs multiples essais thérapeutiques, etc.) De même, en santé mentale, il faudra tenir compte des normes culturelles différentes au moment de poser un diagnostic en lien avec un comportement qui peut sembler inapproprié au clinicien, mais normal dans sa communauté.[2]
Références
- ↑ « 78-1 Concepts de la santé et ses facteurs déterminants | Le Conseil médical du Canada », sur mcc.ca (consulté le 25 mars 2020)
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 et 2,8 Maxime Ouellet, Préparation à l’examen du Conseil Médical Canadien (CMC) : Résumé des objectifs et situations cliniques essentielles du CMC, , 325 p. (lire en ligne)